
|
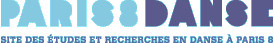
|
Groupe de travail "La recherche avec la pratique chorégraphique (recherche avec la création)"
14 février 2023, 15 mars 2023,...
Ce groupe de travail rassemble 4 doctorant·es, 2 titulaires et 6 chercheur·euses associé·es qui travaillent à partir de méthodologies mobilisant des pratiques tirées de leurs parcours d'artistes ou impliquant une création chorégraphique, ou bien des méthodologies liées à leurs collaborations avec des artistes.
ds
Quand les danseur·euses écrivent sur la nature
21 & 22 février 2022 - Université de Paris, Halle aux Farines
Programme ci-joint ou ici : https://musidanse.univ-paris8.fr/spip.php?article1564
Journées d'études coordonnées par Joanne Clavel, Sylviane Pagès et Julie Perrin, dans le cadre du séminaire de Master "Danses et natures : un projet d'anthologie critique", organisé en collaboration avec le CNRS (LADYSS). Financement IUF.
Avec les présentations de : Capucine Dufour, Axelle Locatelli, Zenaida Marin, Marion Sage.
Il est convenu de penser que les chorégraphes mais aussi nombre de pratiques sociales de la danse tissent des liens avec différentes entités naturelles. Mais sur quelles conceptions et sur quelles pratiques de natures reposent précisément ces danses ? Ce séminaire propose d'aborder la question à partir de l'analyse d'écrits de danseurs et danseuses. Car les textes sont autant d'espaces où se formalise, s'invente et se transmet (en son sein comme plus largement) une culture de la danse mais aussi une culture de la nature. Il s'agira donc de commenter une première sélection de textes réalisée par les organisatrices et collaboratrices du projet, selon les méthodes diverses propres à chacune d'elles (histoire de la danse, histoire des idées, géocritique, philosophies de la nature...). Par « natures », nous entendons inclure la question, par exemple, de l'animal, des vivants, de l'écologie, de la terre, du sauvage, des cellules, des virus, du paysage, du jardin, de l'agriculture, des fêtes rurales, des modes d'existence de la danse hors des grands centres urbains...
Cette anthologie critique à venir, dont nous partagerons l'élaboration, est donc une façon de délimiter la question afin de commencer d'aborder les différentes significations que le mot « nature » peut recouvrir sous la plume des artistes ou praticiens. Il s'agit non seulement de penser avec les artistes, mais encore de se doter de textes de référence commentés, en vue d'offrir un cadre conceptuel fécond pour penser plus avant une question vive de l'époque contemporaine.
Journées d'études coordonnées par Joanne Clavel, Sylviane Pagès et Julie Perrin, dans le cadre du séminaire de Master "Danses et natures : un projet d'anthologie critique", organisé en collaboration avec le CNRS (LADYSS). Financement IUF.
Avec les présentations de : Capucine Dufour, Axelle Locatelli, Zenaida Marin, Marion Sage.
Il est convenu de penser que les chorégraphes mais aussi nombre de pratiques sociales de la danse tissent des liens avec différentes entités naturelles. Mais sur quelles conceptions et sur quelles pratiques de natures reposent précisément ces danses ? Ce séminaire propose d'aborder la question à partir de l'analyse d'écrits de danseurs et danseuses. Car les textes sont autant d'espaces où se formalise, s'invente et se transmet (en son sein comme plus largement) une culture de la danse mais aussi une culture de la nature. Il s'agira donc de commenter une première sélection de textes réalisée par les organisatrices et collaboratrices du projet, selon les méthodes diverses propres à chacune d'elles (histoire de la danse, histoire des idées, géocritique, philosophies de la nature...). Par « natures », nous entendons inclure la question, par exemple, de l'animal, des vivants, de l'écologie, de la terre, du sauvage, des cellules, des virus, du paysage, du jardin, de l'agriculture, des fêtes rurales, des modes d'existence de la danse hors des grands centres urbains...
Cette anthologie critique à venir, dont nous partagerons l'élaboration, est donc une façon de délimiter la question afin de commencer d'aborder les différentes significations que le mot « nature » peut recouvrir sous la plume des artistes ou praticiens. Il s'agit non seulement de penser avec les artistes, mais encore de se doter de textes de référence commentés, en vue d'offrir un cadre conceptuel fécond pour penser plus avant une question vive de l'époque contemporaine.
Rencontre sur nos recherches n° 2 : "Les temps de la recherche"
13 mai 2022, université Paris 8
Coordination : Axelle Locatelli, Marina Ledrein et Julie Perrin.
Avec : Mathieu Bouvier, Luar Escobar, Ivan Jimenez, AnaĂŻs Loison, MĂ©lanie Mesager, Zenaida Marin.
Avec : Mathieu Bouvier, Luar Escobar, Ivan Jimenez, AnaĂŻs Loison, MĂ©lanie Mesager, Zenaida Marin.
Danses et natures : un projet d'anthologie critique
séminaire de recherche et de Master, 2022 (40h).
conduit par Joanne Clavel (CNRS Ladyss/Musidanse), Sylviane Pagès (Musidanse) et Julie Perrin (Musidanse)
Avec Capucine Dufour, Axelle Locatelli (Musidanse), Zenaida Marin, Marion Sage (Musidanse), et d'autres invité·es.
SĂ©minaire en collaboration avec le CNRS (LADYSS).
Il est convenu de penser que les chorégraphes mais aussi nombre de pratiques sociales de la danse tissent des liens avec différentes entités naturelles. Mais sur quelles conceptions et sur quelles pratiques de natures reposent précisément ces danses ? Ce séminaire propose d'aborder la question à partir de l'analyse d'écrits de danseurs et danseuses. Car les textes sont autant d'espaces où se formalise, s'invente et se transmet (en son sein comme plus largement) une culture de la danse mais aussi une culture de la nature. Il s'agira donc de commenter une première sélection de textes réalisée par les organisatrices et collaboratrices du projet, selon les méthodes diverses propres à chacune d'elles (histoire de la danse, histoire des idées, géocritique, philosophies de la nature...). Par « natures », nous entendons inclure la question, par exemple, de l'animal, des vivants, de l'écologie, de la terre, du sauvage, des cellules, des virus, du paysage, du jardin, de l'agriculture, des fêtes rurales, des modes d'existence de la danse hors des grands centres urbains...
Cette anthologie critique à venir, dont nous partagerons l'élaboration, est donc une façon de délimiter la question afin de commencer d'aborder les différentes significations que le mot « nature » peut recouvrir sous la plume des artistes ou praticiens. Il s'agit non seulement de penser avec les artistes, mais encore de se doter de textes de référence commentés, en vue d'offrir un cadre conceptuel fécond pour penser plus avant une question vive de l'époque contemporaine.
Deux journées d'études y sont associées :
"Quand les danseur·euses écrivent sur la nature" : journée d'études coordonnée par J. Clavel, S. Pagès et J. Perrin, 21 et 22 février.
« Sensations animales ». Journée d'études coordonnée par J. Clavel, 21 et 22 mars. Avec : Joanne Clavel, Jeremy Damian, Sylviane Pagès, Julie Perrin, Nadia Vadori Gauthier
Puis : Laurence Pagès, Christine Quoiraud, Violeta Salvatierra, Nadia Vadori Gauthier, Clelia Bilodeau, Bleuène Madelaine, Boris Nordmann, Julie Olivier, Pedro Prazeres, Gabrielle Soo-ah Son, Myriam Suchet, Boris Nordmann .
Avec Capucine Dufour, Axelle Locatelli (Musidanse), Zenaida Marin, Marion Sage (Musidanse), et d'autres invité·es.
SĂ©minaire en collaboration avec le CNRS (LADYSS).
Il est convenu de penser que les chorégraphes mais aussi nombre de pratiques sociales de la danse tissent des liens avec différentes entités naturelles. Mais sur quelles conceptions et sur quelles pratiques de natures reposent précisément ces danses ? Ce séminaire propose d'aborder la question à partir de l'analyse d'écrits de danseurs et danseuses. Car les textes sont autant d'espaces où se formalise, s'invente et se transmet (en son sein comme plus largement) une culture de la danse mais aussi une culture de la nature. Il s'agira donc de commenter une première sélection de textes réalisée par les organisatrices et collaboratrices du projet, selon les méthodes diverses propres à chacune d'elles (histoire de la danse, histoire des idées, géocritique, philosophies de la nature...). Par « natures », nous entendons inclure la question, par exemple, de l'animal, des vivants, de l'écologie, de la terre, du sauvage, des cellules, des virus, du paysage, du jardin, de l'agriculture, des fêtes rurales, des modes d'existence de la danse hors des grands centres urbains...
Cette anthologie critique à venir, dont nous partagerons l'élaboration, est donc une façon de délimiter la question afin de commencer d'aborder les différentes significations que le mot « nature » peut recouvrir sous la plume des artistes ou praticiens. Il s'agit non seulement de penser avec les artistes, mais encore de se doter de textes de référence commentés, en vue d'offrir un cadre conceptuel fécond pour penser plus avant une question vive de l'époque contemporaine.
Deux journées d'études y sont associées :
"Quand les danseur·euses écrivent sur la nature" : journée d'études coordonnée par J. Clavel, S. Pagès et J. Perrin, 21 et 22 février.
« Sensations animales ». Journée d'études coordonnée par J. Clavel, 21 et 22 mars. Avec : Joanne Clavel, Jeremy Damian, Sylviane Pagès, Julie Perrin, Nadia Vadori Gauthier
Puis : Laurence Pagès, Christine Quoiraud, Violeta Salvatierra, Nadia Vadori Gauthier, Clelia Bilodeau, Bleuène Madelaine, Boris Nordmann, Julie Olivier, Pedro Prazeres, Gabrielle Soo-ah Son, Myriam Suchet, Boris Nordmann .
La FĂŞte dansante. Pratiques, imaginaires et cultures festives en danse
8 et 9 octobre 2021, CND
Sous la direction de Camille Paillet (Université Paris 8, Musidanse/Université Paris 1 Sorbonne, CHS) et Laura Steil (Université Paris 8).
Programme ci-joint. Avec les interventions de membres de l'Ă©quipe : Camille Paillet, Julie Perrin, Christine Roquet.
À l'appel du confinement, diurne et nocturne, l'espace festif est devenu suspect et identifié comme dangereux. Jugées comme des activités « non essentielles » par le gouvernement, les pratiques festives, et avec elles les activités et les valeurs qu'elles déploient, sont officiellement interdites dans l'espace public et déconseillées dans la sphère privée. Outre les dégâts économiques causés par cette interdiction et les réactions critiques qu'elles génèrent, ces journées d'études accueillies au CN D questionnent les effets de ces mesures coercitives sur le monde social, les sens et les fonctions festives de la danse.
Comité scientifique :
Christophe Apprill (URMIS), Andreas Fickers (UniLu, C2DH), Thomas Fouquet (IMAF, CNRS), Pascale Goetschel (Université Paris 1 Sorbonne, CHS), Isabelle Launay (Université Paris 8, Musidanse), Marina Nordera (Université Côte d'Azur, CTEL), Claudia Palazzolo (Université Lumière Lyon 2, Passages XX-XXI), Joëlle Vellet (Université Côte d'Azur, CTEL)
Programme ci-joint. Avec les interventions de membres de l'Ă©quipe : Camille Paillet, Julie Perrin, Christine Roquet.
À l'appel du confinement, diurne et nocturne, l'espace festif est devenu suspect et identifié comme dangereux. Jugées comme des activités « non essentielles » par le gouvernement, les pratiques festives, et avec elles les activités et les valeurs qu'elles déploient, sont officiellement interdites dans l'espace public et déconseillées dans la sphère privée. Outre les dégâts économiques causés par cette interdiction et les réactions critiques qu'elles génèrent, ces journées d'études accueillies au CN D questionnent les effets de ces mesures coercitives sur le monde social, les sens et les fonctions festives de la danse.
Comité scientifique :
Christophe Apprill (URMIS), Andreas Fickers (UniLu, C2DH), Thomas Fouquet (IMAF, CNRS), Pascale Goetschel (Université Paris 1 Sorbonne, CHS), Isabelle Launay (Université Paris 8, Musidanse), Marina Nordera (Université Côte d'Azur, CTEL), Claudia Palazzolo (Université Lumière Lyon 2, Passages XX-XXI), Joëlle Vellet (Université Côte d'Azur, CTEL)
Séance autour de l'ouvrage : "Vu du geste. Interpréter le mouvement danse", avec Guilherme HINZ, Olga MOLL, Christine ROQUET, Makis SOLOMOS
15 novembre 2021, 15h-18h, université Paris 8, salle A2-217
Dans le cadre du séminaire MUSIDANSE.
Dans ce livre, Christine Roquet interroge les différents savoirs implicites dont on trouve la trace dans la langue spécifique des danseurs : que veulent-ils dire lorsqu'ils parlent de « s'appuyer sur l'espace », de « donner son poids » ou de « danser à l'écoute » ? La danse est-elle une affaire de corps ? Pourquoi parler de geste plutôt que de mouvement ? Qu'en est-il de l'état de corps, de l'émotion, du partage de l'espace, lorsque nous dansons ou nous regardons danser ? Qu'est-ce que lire le geste dansé ? Comme s'y prend-on et avec quels outils ? Comment les savoirs de la pratique circulent-ils en danse, entre danse de scène et danse de bal par exemple ? Et quelle pensée de l'altérité ou quelle théorie de l'imaginaire peuvent nous aider à développer les « manières de faire » des danseurs ?
Durant ce séminaire, les invités interrogeront à leur tour Christine Roquet sur ses propositions, tant du point de la danse que de celui de la musique.
Dans ce livre, Christine Roquet interroge les différents savoirs implicites dont on trouve la trace dans la langue spécifique des danseurs : que veulent-ils dire lorsqu'ils parlent de « s'appuyer sur l'espace », de « donner son poids » ou de « danser à l'écoute » ? La danse est-elle une affaire de corps ? Pourquoi parler de geste plutôt que de mouvement ? Qu'en est-il de l'état de corps, de l'émotion, du partage de l'espace, lorsque nous dansons ou nous regardons danser ? Qu'est-ce que lire le geste dansé ? Comme s'y prend-on et avec quels outils ? Comment les savoirs de la pratique circulent-ils en danse, entre danse de scène et danse de bal par exemple ? Et quelle pensée de l'altérité ou quelle théorie de l'imaginaire peuvent nous aider à développer les « manières de faire » des danseurs ?
Durant ce séminaire, les invités interrogeront à leur tour Christine Roquet sur ses propositions, tant du point de la danse que de celui de la musique.
Projets artistiques corporellement et socialement engagés en institutions : défaire l'institution, refaire un milieu
14 décembre 2021, 10h-18h, Paris 8, Amphi X
Animation : Isabelle Ginot et Marina Ledrein.
Journée d'études Arts, Ecologies et Transitions / Mouvements engagés
Cette journée d'études croise deux séminaires : Arts, écologies, transitions : construire une référence commune, et Mouvements engagés qui réfléchit sur des projets chorégraphiques conduits en institutions soignantes, dans une époque où ces institutions sont plus en souffrance que jamais. Les nourritures écosophiques peuvent-elles quelque chose pour ces établissements où se condensent souffrances psychiques, corporelles et précarisation sociale, mais aussi parfois enfermement et ségrégation des populations ? Les savoirs de l'art, de l'écoute et du sensible sauraient-ils infiltrer ces environnements puissamment aseptisés et isolés, pour les transformer en milieux vivants et milieux pour les vivants ? Que peut-on penser à propos de ces espaces d'exclusion, depuis les champs du cinéma, des arts visuels, sonores ou du mouvement ? Il s'agira de rêver ensemble comment protéger des formes vivantes de subjectivation, dans ces contextes de désertification organisée de l'imaginaire. Comment inclure dans nos imaginaires et nos luttes écosophiques, l'existence de ces territoires forclos et trop souvent oubliés, et reconnaître ce qui peut être appris de ces autres vitesses, autres rythmes, autres modèles de mouvement, d'habiter et de penser.
Journée d'études Arts, Ecologies et Transitions / Mouvements engagés
Cette journée d'études croise deux séminaires : Arts, écologies, transitions : construire une référence commune, et Mouvements engagés qui réfléchit sur des projets chorégraphiques conduits en institutions soignantes, dans une époque où ces institutions sont plus en souffrance que jamais. Les nourritures écosophiques peuvent-elles quelque chose pour ces établissements où se condensent souffrances psychiques, corporelles et précarisation sociale, mais aussi parfois enfermement et ségrégation des populations ? Les savoirs de l'art, de l'écoute et du sensible sauraient-ils infiltrer ces environnements puissamment aseptisés et isolés, pour les transformer en milieux vivants et milieux pour les vivants ? Que peut-on penser à propos de ces espaces d'exclusion, depuis les champs du cinéma, des arts visuels, sonores ou du mouvement ? Il s'agira de rêver ensemble comment protéger des formes vivantes de subjectivation, dans ces contextes de désertification organisée de l'imaginaire. Comment inclure dans nos imaginaires et nos luttes écosophiques, l'existence de ces territoires forclos et trop souvent oubliés, et reconnaître ce qui peut être appris de ces autres vitesses, autres rythmes, autres modèles de mouvement, d'habiter et de penser.
Séance autour de "Composer en danse. Un vocabulaire des opérations et des pratiques"
9 avril 2021
Dans le cadre du séminaire MUSIDANSE.
Intervenant.es : chercheur.euses associé.es au laboratoire Musidanse (Myrto Katsiki, Isabelle Launay, Olga Moll, Simon Marsan, Valentina Morales, Alvaro Oviedo).
Séance autour de l'ouvrage : Composer en danse. Un vocabulaire des opérations et des pratiques (Les presses du réel, collection Nouvelles scènes/Manufacture, 2019).
Cette est sera l'occasion pour les auteures Yvane Chapuis (Responsable de la recherche à La Manufacture, Lausanne), Myriam Gourfink (chorégraphe, Cie Lol danse, Paris) et Julie Perrin (Musidanse, université Paris 8) de présenter brièvement cet ouvrage et d'échanger à partir de questions et impressions de chercheurs-lecteurs.
Intervenant.es : chercheur.euses associé.es au laboratoire Musidanse (Myrto Katsiki, Isabelle Launay, Olga Moll, Simon Marsan, Valentina Morales, Alvaro Oviedo).
Séance autour de l'ouvrage : Composer en danse. Un vocabulaire des opérations et des pratiques (Les presses du réel, collection Nouvelles scènes/Manufacture, 2019).
Cette est sera l'occasion pour les auteures Yvane Chapuis (Responsable de la recherche à La Manufacture, Lausanne), Myriam Gourfink (chorégraphe, Cie Lol danse, Paris) et Julie Perrin (Musidanse, université Paris 8) de présenter brièvement cet ouvrage et d'échanger à partir de questions et impressions de chercheurs-lecteurs.
Rencontre sur nos recherches n° 0
19 février 2021, université Paris 8
Coordination : Isabelle Ginot, Isabelle Launay, Laurent Pichaud, Julie Perrin.
Avec : Luar Escobar, Ivan Jimenez, Mahalia Lassibille, Axelle Locatelli, Anaïs Loison-Bouvet, Valentina Morales, Claire Vionnet. Et à distance : Sanja Andus (sur un fuseau horaire new-yorkais) ; Marie Bardet (sur un fuseau horaire argentin) ; Paola Braga ; Pauline Le Boulba ; Fernando Lopez Rodriguez ; Sylviane Pagès (l'après-midi) ; Camille Paillet ; Guillaume Sintès ; Violeta Salvatierra.
Avec : Luar Escobar, Ivan Jimenez, Mahalia Lassibille, Axelle Locatelli, Anaïs Loison-Bouvet, Valentina Morales, Claire Vionnet. Et à distance : Sanja Andus (sur un fuseau horaire new-yorkais) ; Marie Bardet (sur un fuseau horaire argentin) ; Paola Braga ; Pauline Le Boulba ; Fernando Lopez Rodriguez ; Sylviane Pagès (l'après-midi) ; Camille Paillet ; Guillaume Sintès ; Violeta Salvatierra.
Les écrits d'artistes chorégraphiques dans les recherches en danse
16 et 18 mars 2019, université Paris 8
Journées d'étude organisées par Julie Perrin, IUF. Programme ci-joint
Avec Marie Glon (Université de Lille), Laurent Pichaud (Université Paris 8 Musidanse), Sylviane Pagès (Université Paris 8 Musidanse), Mélanie Papin (Musidanse), Guillaume Sintès (Université de Strasbourg, Musidanse), Patricia Ferrara (chorégraphe, Université de Toulouse), Laetitia Angot (chorégraphe), Pauline Chevalier (INHA), Guilherme Hinz (Université Paris 8 Musidanse), Anaïs Loison (Université Paris 8 Musidanse), Paule Gioffredi (Université Lyon 2) et Julie Perrin (Université Paris 8 Musidanse, IUF).
Avec Marie Glon (Université de Lille), Laurent Pichaud (Université Paris 8 Musidanse), Sylviane Pagès (Université Paris 8 Musidanse), Mélanie Papin (Musidanse), Guillaume Sintès (Université de Strasbourg, Musidanse), Patricia Ferrara (chorégraphe, Université de Toulouse), Laetitia Angot (chorégraphe), Pauline Chevalier (INHA), Guilherme Hinz (Université Paris 8 Musidanse), Anaïs Loison (Université Paris 8 Musidanse), Paule Gioffredi (Université Lyon 2) et Julie Perrin (Université Paris 8 Musidanse, IUF).
Pratiques du geste à la croisée des chemins
10, 11 et 12 décembre 2019, université Paris 8
Titre complet : Pratiques du geste à la croisée des chemins. Analyses de pratiques pédagogiques, anthropologiques et artistiques au Brésil. VIème colloque international du Groupe de recherche « Arts du geste » (Brésil/France).
Actes des colloques du Groupe de recherche « Arts du geste », 1 (ISSN 2743-5814) disponible ci-joint.
Colloque organisé par Guilherme Hinz (Paris 8, Musidanse) et Christine Roquet (Paris 8, Musidanse).
Avec : Daniela Maria Amoroso (UFBA), Sandra R. O. Santana (UFBA), Mônica Fagundes Dantas (UFRGS), Celina Nunes de Alcântara (UFRGS), Suzi Weber da Silva (UFRGS), Heloisa Gravina (UFSM), Marisa Lambert (UNICAMP), Adriana Bonfatti (UNIRIO), Juliana Manhães (UNIRIO), Maria Enamar Ramos (UNIRIO), Joana Ribeiro da Silva Tavares (UNIRIO), Gustavo Côrtes (UFMG), Guilherme Hinz (Paris 8), Christine Roquet (Paris 8).
Le VIème colloque international du groupe de recherche « Arts du geste » (Brésil/France) s'inscrit dans la suite d'une longue série de colloques, journées d'études et échanges de travaux de recherche entre plusieurs universités brésiliennes (UNIRIO, UFRGS, UFC, UFBA, UFMG) et le département Danse de l'université Paris 8, depuis 2011.
Lors de ces rencontres, nous avons toujours tenté de confronter nos regards, nos outils épistémologiques et d'échanger sur nos pratiques en centrant nos problématiques sur le geste dansé. En théorie comme en pratique, nous avons pu mettre conjointement en travail différents outils d'analyse (analyse du mouvement Laban/Bartenieff, approche complexe du geste expressif développée à Paris 8, etc.) et enrichir ainsi nos perspectives mutuelles.
Cette session 2019 est davantage destinĂ©e Ă permettre aux chercheuses et chercheurs brĂ©siliens de partager avec le public français les nouvelles questions qui nourrissent leurs pensĂ©es et leurs recherches actuelles sur la danse et les arts du mouvement au BrĂ©sil. Nos collègues prĂ©senteront des analyses de pratiques artistiques, anthropologiques et pĂ©dagogiques Ă partir d'un corpus variĂ©. Danses traditionnelles et pratiques ancestrales, œuvres chorĂ©graphiques, pratiques d'analyse du mouvement dans la formation de l'actant... Les recherches seront prĂ©sentĂ©es sous forme de confĂ©rences, ateliers ou projection documentaire. Une large partie du temps dĂ©diĂ© sera rĂ©servĂ© Ă la discussion avec le public. Ainsi, nos questionnements mutuels sur les Arts du geste pourront continuer Ă se dĂ©velopper et Ă participer Ă la circulation de savoirs toujours plus vastes issus de nos cultures respectives.
Actes des colloques du Groupe de recherche « Arts du geste », 1 (ISSN 2743-5814) disponible ci-joint.
Colloque organisé par Guilherme Hinz (Paris 8, Musidanse) et Christine Roquet (Paris 8, Musidanse).
Avec : Daniela Maria Amoroso (UFBA), Sandra R. O. Santana (UFBA), Mônica Fagundes Dantas (UFRGS), Celina Nunes de Alcântara (UFRGS), Suzi Weber da Silva (UFRGS), Heloisa Gravina (UFSM), Marisa Lambert (UNICAMP), Adriana Bonfatti (UNIRIO), Juliana Manhães (UNIRIO), Maria Enamar Ramos (UNIRIO), Joana Ribeiro da Silva Tavares (UNIRIO), Gustavo Côrtes (UFMG), Guilherme Hinz (Paris 8), Christine Roquet (Paris 8).
Le VIème colloque international du groupe de recherche « Arts du geste » (Brésil/France) s'inscrit dans la suite d'une longue série de colloques, journées d'études et échanges de travaux de recherche entre plusieurs universités brésiliennes (UNIRIO, UFRGS, UFC, UFBA, UFMG) et le département Danse de l'université Paris 8, depuis 2011.
Lors de ces rencontres, nous avons toujours tenté de confronter nos regards, nos outils épistémologiques et d'échanger sur nos pratiques en centrant nos problématiques sur le geste dansé. En théorie comme en pratique, nous avons pu mettre conjointement en travail différents outils d'analyse (analyse du mouvement Laban/Bartenieff, approche complexe du geste expressif développée à Paris 8, etc.) et enrichir ainsi nos perspectives mutuelles.
Cette session 2019 est davantage destinĂ©e Ă permettre aux chercheuses et chercheurs brĂ©siliens de partager avec le public français les nouvelles questions qui nourrissent leurs pensĂ©es et leurs recherches actuelles sur la danse et les arts du mouvement au BrĂ©sil. Nos collègues prĂ©senteront des analyses de pratiques artistiques, anthropologiques et pĂ©dagogiques Ă partir d'un corpus variĂ©. Danses traditionnelles et pratiques ancestrales, œuvres chorĂ©graphiques, pratiques d'analyse du mouvement dans la formation de l'actant... Les recherches seront prĂ©sentĂ©es sous forme de confĂ©rences, ateliers ou projection documentaire. Une large partie du temps dĂ©diĂ© sera rĂ©servĂ© Ă la discussion avec le public. Ainsi, nos questionnements mutuels sur les Arts du geste pourront continuer Ă se dĂ©velopper et Ă participer Ă la circulation de savoirs toujours plus vastes issus de nos cultures respectives.
Karin Waehner, Exposer / performer l'archive
16 décembre 2017, BnF
Colloque organisé par Sylviane Pagès, Mélanie Papin et Guillaume Sintès dans le cadre des activités du Groupe de recherche «Histoire contemporaine du champ chorégraphique en France» (Musidanse, Université Paris 8), en partenariat avec le Département des Arts du Spectacle de la BnF, et l'aimable concours de Jean Masse.
Projet soutenu par le Labex Arts H2H.
Projet soutenu par le Labex Arts H2H.
Créer à deux : Klauss et Angel Vianna
29 avril 2017, université Paris 8
Journée d'études organisée par Joana Tavares (UNIRIO) et Christine Roquet (université Paris 8, Musidanse) en collaboration avec Luar Maria Escobar (UNIRIO et université Paris 8, Musidanse) et Guilherme Hinz (université Paris 8, Musidanse).
Cette journĂ©e d'Ă©tudes, liĂ©e au cours « Danser Ă deux » de Christine Roquet, prĂ©sentera un Ă©tat des lieux de l'œuvre et de la trajectoire du couple pionnier de la danse moderne brĂ©silienne : Angel Vianna (1928-) et Klauss Vianna (1928-1992). Leur recherche dans les arts du mouvement s'inscrit d'abord dans le cadre de la danse moderne brĂ©silienne des annĂ©es 1950 et s'est par la suite Ă©tendue Ă diffĂ©rents terrains, tels que le théâtre, la musique, l'Ă©ducation somatique et le milieu des soins et de la santĂ© mentale. De nos jours, le travail corporel des Vianna continue son essor Ă la Escola e Faculdade Angel Vianna Ă Rio de Janeiro (crĂ©Ă©e en 1983) et se poursuit Ă travers plusieurs gĂ©nĂ©rations de danseurs et de chercheurs rĂ©sidants au BrĂ©sil comme Ă l'Ă©tranger.
Programme ci-joint.
Avec Joana Ribeiro da Silva Tavares, Lucia Helena Machado, Eduardo Costilhes, Angela Loureiro, Guilherme Hinz, Enamar Ramos, Christine Roquet, Isabelle Ginot, Luar Maria Escobar, Maria Alice Poppe, Marlon Miguel.
Vidéo avec quelques extraits de la journée : https://youtu.be/ZTPDq7Lym7s
Cette journĂ©e d'Ă©tudes, liĂ©e au cours « Danser Ă deux » de Christine Roquet, prĂ©sentera un Ă©tat des lieux de l'œuvre et de la trajectoire du couple pionnier de la danse moderne brĂ©silienne : Angel Vianna (1928-) et Klauss Vianna (1928-1992). Leur recherche dans les arts du mouvement s'inscrit d'abord dans le cadre de la danse moderne brĂ©silienne des annĂ©es 1950 et s'est par la suite Ă©tendue Ă diffĂ©rents terrains, tels que le théâtre, la musique, l'Ă©ducation somatique et le milieu des soins et de la santĂ© mentale. De nos jours, le travail corporel des Vianna continue son essor Ă la Escola e Faculdade Angel Vianna Ă Rio de Janeiro (crĂ©Ă©e en 1983) et se poursuit Ă travers plusieurs gĂ©nĂ©rations de danseurs et de chercheurs rĂ©sidants au BrĂ©sil comme Ă l'Ă©tranger.
Programme ci-joint.
Avec Joana Ribeiro da Silva Tavares, Lucia Helena Machado, Eduardo Costilhes, Angela Loureiro, Guilherme Hinz, Enamar Ramos, Christine Roquet, Isabelle Ginot, Luar Maria Escobar, Maria Alice Poppe, Marlon Miguel.
Vidéo avec quelques extraits de la journée : https://youtu.be/ZTPDq7Lym7s
Arts, Ă©cologies et transitions
13 février 2016, INHA
Journée de recherche TEAMeD-Paris 8, MUSIDANSE Université Paris 8
9h15 Accueil / Introduction
9h30-10h10
Agostino Di Scipio (compositeur, Italie), Julie Perrin (MUSIDANSE, Université Paris 8)
10h10-10h50 DĂ©bat
Pause (20 minutes)
11h10-11h50
Lorraine Verner (École des Beaux-Arts de Versailles, TEAMeD Paris 8), Carme Pardo (Université de Girone, Espagne)
11h50-12h30 DĂ©bat
12h30-13h40 Pause déjeuner
13h40-14h40
Roberto Barbanti (TEAMeD, Université Paris 8), Joanne Clavel (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris et Natural movement), Makis Solomos (MUSIDANSE, Université Paris 8),
14h40-15h40 DĂ©bat
Pause (20 minutes)
16h-17h
Isabelle Ginot (MUSIDANSE, Université Paris 8), Kostas Paparrigopoulos (Institut Technologique et Éducatif de Crète, Grèce), Tiziana Villani (NABA/Milan et Université Sapienza/Rome, TEAMeD Paris 8)
17h-18h DĂ©bat
9h15 Accueil / Introduction
9h30-10h10
Agostino Di Scipio (compositeur, Italie), Julie Perrin (MUSIDANSE, Université Paris 8)
10h10-10h50 DĂ©bat
Pause (20 minutes)
11h10-11h50
Lorraine Verner (École des Beaux-Arts de Versailles, TEAMeD Paris 8), Carme Pardo (Université de Girone, Espagne)
11h50-12h30 DĂ©bat
12h30-13h40 Pause déjeuner
13h40-14h40
Roberto Barbanti (TEAMeD, Université Paris 8), Joanne Clavel (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris et Natural movement), Makis Solomos (MUSIDANSE, Université Paris 8),
14h40-15h40 DĂ©bat
Pause (20 minutes)
16h-17h
Isabelle Ginot (MUSIDANSE, Université Paris 8), Kostas Paparrigopoulos (Institut Technologique et Éducatif de Crète, Grèce), Tiziana Villani (NABA/Milan et Université Sapienza/Rome, TEAMeD Paris 8)
17h-18h DĂ©bat
La recherche en-deçà du temps de l'écriture
Soirée de l'association des chercheurs en danse, 11 février 2016, CND, Pantin
Responsable : l'association des chercheurs en danse
Coordination : Beatrice Boldrin, Julie Perrin (université Paris 8 - MUSIDANSE), Antonella Poli, Claude Sorin et Ninon Steinhausser (université Paris 8 - MUSIDANSE)
Participantes : Aurore Després (Université de Franche-Comté), Alice Gervais-Ragu (université Paris 8 - MUSIDANSE), Betty Lefèvre (université de Rouen), Mahalia Lassibille (université Paris 8 - MUSIDANSE), Claude Sorin (artiste, enseignante en histoire de la danse), Joëlle Vellet (université Nice Sofia Antipolis)
La publication d'un texte identifie souvent l'activitĂ© de recherche. Mais cette Ă©tape de formalisation Ă©crite ne reprĂ©sente que l'aboutissement d'un processus. Ce dernier confronte les chercheurs Ă un important travail basĂ©, selon les cas, sur l'enquĂŞte, la rĂ©colte d'informations, l'interprĂ©tation d'archives, l'analyse des gestes et des œuvres, la pratique des danses, la lecture des Ă©crits d'artistes et thĂ©oriciens, ou le dĂ©bat intellectuel. En quoi consiste l'activitĂ© du chercheur en danse ?
Les six chercheuses invitées, toutes membres actives de l'aCD, proposent de rendre compte d'un des aspects de cette activité invisible menée en-deçà du temps de l'écriture. Elles témoigneront de leurs manières de faire et des questions qui se posent à elles dans le quotidien de leur pratique de chercheuses. La soirée s'organisera suivant trois fils rouges : Regards, Milieux, Oralités. Comme une façon de nommer trois sphères du travail de recherche : l'observation, l'immersion et la parole. En quoi ces démarches peuvent-elles résonner avec l'activité de recherche d'un artiste ? Le chorégraphe
Regards
« La recherche de terrain comme activité perceptive et réflexive », par Betty Lefèvre & Joëlle Vellet
ll s'agit de montrer qu'il n'y a pas une réalité déjà là (de la danse ou de tout autre objet de recherche) qu'il suffirait de voir pour la connaître. L'activité du chercheur est une activité de construction du regard - regard questionnant, curieux, qui ne sollicite pas seulement la vue mais qui engage le corps tout entier. Cette posture de chercheur observant (et observé), loin d'être un obstacle épistémologique, est source féconde de connaissances. Par ailleurs, ce qui est observé ne permettant d'accéder qu'aux traces de ce qui se joue à l'instant, l'activité du chercheur met en jeu, dans un rapport dialogique avec l'artiste, les conditions pour accéder à une co-connaissance, à une co-construction de savoirs, dévoilant ce qui n'est pas observable mais présent.
Milieux
« Sujets-milieux, objets-milieux, productions-milieux, réceptions-milieux : recherche-milieu ? », par Alice Gervais-Ragu
Quelle méthodologie, quelle posture de recherche, quel commun se construisent entre une chercheuse et ce/ceux qu'elle est amenée à rencontrer durant son parcours de recherche ? Hors le temps de l'écriture, comment de multiples formes de pensées et de sensibilité s'inventent finalement, saisies entre rencontre et expérience, relation et distance ? Quelle dramaturgie de la recherche s'invente alors ?
« Recherches ''au milieu'' : le Diplôme Universitaire Art, danse et performance de l'université de Franche-Comté », par Aurore Després
ExpĂ©rimentations, perceptions, rĂ©flexions, lectures, rencontres et dĂ©bats ont constituĂ© le cœur des dispositifs qu'ont investis plus de 150 artistes, chercheurs, acteurs culturels au sein du D.U Art, danse et performance entre 2011 et 2014. Comment ces pratiques de recherche expĂ©rimentales ou exploratoires dĂ©finissent-elles Ă la fois des formes, des postures et des mĂ©thodologies de recherche « au milieu » que l'on retrouve tout aussi bien dans l'ouvrage Gestes en Ă©clats. Art, danse et performance (Presses du rĂ©el, 2016) qui les ressaisit et les prolonge ?
Oralités
« Ethno-graphie d'une recherche en danse : les entrelacs entre oralité et écriture », par Mahalia Lassibille
L'oralité et l'écriture sont parfois considérées comme des étapes de travail séparées pour un chercheur qui étudie des sociétés et des pratiques dites justement « orales ». Or, quand on se penche sur le concret de son activité de recherche, c'est plutôt leurs entrelacs qu'il s'agit d'envisager : non seulement notre pensée est forgée par la graphie, mais les écrits scientifiques ont des effets retours sur les acteurs étudiés. Ceci conduit dès lors à décloisonner l'oral et l'écrit, le chercheur et les acteurs, l'en deçà et l'au-delà du temps de l'écriture.
« Rendre visite aux mots, encore, est une sorte de visite », par Claude Sorin
Avec les mots de Simone Forti, il s'agit de découvrir les liens entre oralité, danse et écriture que cette artiste explore. Une écriture en deçà de la danse, performée, puis réécrite.
À l'écoute de quelques extraits d'une interview, nous entendrons cette proximité du corps et des mots, une danse-récit, dit-elle. Par l'évocation de cette artiste, il s'agit de tendre l'oreille à certains usages de l'oralité en danse.
Coordination : Beatrice Boldrin, Julie Perrin (université Paris 8 - MUSIDANSE), Antonella Poli, Claude Sorin et Ninon Steinhausser (université Paris 8 - MUSIDANSE)
Participantes : Aurore Després (Université de Franche-Comté), Alice Gervais-Ragu (université Paris 8 - MUSIDANSE), Betty Lefèvre (université de Rouen), Mahalia Lassibille (université Paris 8 - MUSIDANSE), Claude Sorin (artiste, enseignante en histoire de la danse), Joëlle Vellet (université Nice Sofia Antipolis)
La publication d'un texte identifie souvent l'activitĂ© de recherche. Mais cette Ă©tape de formalisation Ă©crite ne reprĂ©sente que l'aboutissement d'un processus. Ce dernier confronte les chercheurs Ă un important travail basĂ©, selon les cas, sur l'enquĂŞte, la rĂ©colte d'informations, l'interprĂ©tation d'archives, l'analyse des gestes et des œuvres, la pratique des danses, la lecture des Ă©crits d'artistes et thĂ©oriciens, ou le dĂ©bat intellectuel. En quoi consiste l'activitĂ© du chercheur en danse ?
Les six chercheuses invitées, toutes membres actives de l'aCD, proposent de rendre compte d'un des aspects de cette activité invisible menée en-deçà du temps de l'écriture. Elles témoigneront de leurs manières de faire et des questions qui se posent à elles dans le quotidien de leur pratique de chercheuses. La soirée s'organisera suivant trois fils rouges : Regards, Milieux, Oralités. Comme une façon de nommer trois sphères du travail de recherche : l'observation, l'immersion et la parole. En quoi ces démarches peuvent-elles résonner avec l'activité de recherche d'un artiste ? Le chorégraphe
Regards
« La recherche de terrain comme activité perceptive et réflexive », par Betty Lefèvre & Joëlle Vellet
ll s'agit de montrer qu'il n'y a pas une réalité déjà là (de la danse ou de tout autre objet de recherche) qu'il suffirait de voir pour la connaître. L'activité du chercheur est une activité de construction du regard - regard questionnant, curieux, qui ne sollicite pas seulement la vue mais qui engage le corps tout entier. Cette posture de chercheur observant (et observé), loin d'être un obstacle épistémologique, est source féconde de connaissances. Par ailleurs, ce qui est observé ne permettant d'accéder qu'aux traces de ce qui se joue à l'instant, l'activité du chercheur met en jeu, dans un rapport dialogique avec l'artiste, les conditions pour accéder à une co-connaissance, à une co-construction de savoirs, dévoilant ce qui n'est pas observable mais présent.
Milieux
« Sujets-milieux, objets-milieux, productions-milieux, réceptions-milieux : recherche-milieu ? », par Alice Gervais-Ragu
Quelle méthodologie, quelle posture de recherche, quel commun se construisent entre une chercheuse et ce/ceux qu'elle est amenée à rencontrer durant son parcours de recherche ? Hors le temps de l'écriture, comment de multiples formes de pensées et de sensibilité s'inventent finalement, saisies entre rencontre et expérience, relation et distance ? Quelle dramaturgie de la recherche s'invente alors ?
« Recherches ''au milieu'' : le Diplôme Universitaire Art, danse et performance de l'université de Franche-Comté », par Aurore Després
ExpĂ©rimentations, perceptions, rĂ©flexions, lectures, rencontres et dĂ©bats ont constituĂ© le cœur des dispositifs qu'ont investis plus de 150 artistes, chercheurs, acteurs culturels au sein du D.U Art, danse et performance entre 2011 et 2014. Comment ces pratiques de recherche expĂ©rimentales ou exploratoires dĂ©finissent-elles Ă la fois des formes, des postures et des mĂ©thodologies de recherche « au milieu » que l'on retrouve tout aussi bien dans l'ouvrage Gestes en Ă©clats. Art, danse et performance (Presses du rĂ©el, 2016) qui les ressaisit et les prolonge ?
Oralités
« Ethno-graphie d'une recherche en danse : les entrelacs entre oralité et écriture », par Mahalia Lassibille
L'oralité et l'écriture sont parfois considérées comme des étapes de travail séparées pour un chercheur qui étudie des sociétés et des pratiques dites justement « orales ». Or, quand on se penche sur le concret de son activité de recherche, c'est plutôt leurs entrelacs qu'il s'agit d'envisager : non seulement notre pensée est forgée par la graphie, mais les écrits scientifiques ont des effets retours sur les acteurs étudiés. Ceci conduit dès lors à décloisonner l'oral et l'écrit, le chercheur et les acteurs, l'en deçà et l'au-delà du temps de l'écriture.
« Rendre visite aux mots, encore, est une sorte de visite », par Claude Sorin
Avec les mots de Simone Forti, il s'agit de découvrir les liens entre oralité, danse et écriture que cette artiste explore. Une écriture en deçà de la danse, performée, puis réécrite.
À l'écoute de quelques extraits d'une interview, nous entendrons cette proximité du corps et des mots, une danse-récit, dit-elle. Par l'évocation de cette artiste, il s'agit de tendre l'oreille à certains usages de l'oralité en danse.
Éco-Somatiques
du 8 au 10 décembre 2014 au Centre National de la Danse, Pantin
À l'initiative de « Soma&Po. Somatiques, Esthétiques, Politiques », Groupe de recherche, laboratoire « Analyse des discours et pratiques en danse », Université Paris 8 Saint-Denis Vincennes
Comité organisateur :
Bottiglieri Carla (Université Paris 8)
Clavel Joanne (Université Paris 8, Muséum National d'Histoire Naturelle)
Ginot Isabelle (Université Paris 8)
Collectif Natural Movement
Comité scientifique
Bardet Marie (Université Paris 8, Université de Buenos Aires)
Bottiglieri Carla (Université Paris 8)
Clavel Joanne (Université Paris 8, Muséum National d'Histoire Naturelle)
Ginot Isabelle (Université Paris 8)
Salvatierra garcĂa de QuirĂłs Violetta (UniversitĂ© Paris 8)
ARCHIVES du colloque accessibles ici : http://natural-movement.fr/files/CONFERENCES/ecosomatiques/presentation.html
Les « pratiques somatiques » sont un ensemble de pratiques corporelles dont l'émergence en Occident commence au tournant du 20e siècle, et qui continuent à se développer jusqu'à aujourd'hui. Les initiateurs de ces méthodes argumentent le développement des méthodes d'éducation somatique comme une réponse directement issue des problèmes environnementaux causés par l'industrialisation grandissante des pays occidentaux et l'impact de ces changements sur les modes de vie (Gindler, Todd, Feldenkrais). L'urbanisation, les problèmes de pollutions, l'accélération des rythmes de vie et du rendement du travail modifient le quotidien des individus dont la qualité de vie en terme de corporéité se dégrade aussi vite que leur environnement. Dès ces débuts on peut proposer de construire une histoire de ces pratiques en regard d'une « contreculture verte », même si sa pratique actuelle en France, et dans l'ensemble des société post-industrielles, s'est normalisée au sein du vaste marché du « bien-être » récupérant au passage les pratiques corporelles orientales (yoga, taï-chi, qi qong...). En effet, les pratiques somatiques s'apparentent à ce qu'on pourrait appeler une « créativité environnementale » en réponse aux dégradations écologiques, dont il reste encore à cerner les modes de fonctionnement et le statut par rapport aux politiques publiques de soin, des loisirs et du monde des arts vivants.
Les pratiques somatiques ont connu un essor croissant dans le monde de l'art chorégraphique. Que les danseurs usent des somatiques à des fins purement techniques (efficacité et amplitude de mouvement), d'interprétation (gamme de nuances qualitatives du geste) ou encore personnelles (plaisir de se mettre en mouvement, de partager une pratique), tous veulent nourrir leurs connaissances par un ressenti interne reliant ainsi savoirs et savoir-faire. Combien, et comment, l'insertion des pratiques somatiques dans le champ chorégraphique vient-elle poser la question du rapport au monde, déplacer certaines approches de ce qu'il est difficile d'appeler « LE corps », ouvrir à un autre regard sur le rapport au milieu et aux autres ? En d'autres termes, en quoi peuvent-elles être vecteurs de questionnements politiques ? D'ailleurs, cet usage des danseurs est souvent à rapprocher de pratiques sociologiques plus globalement proches des mouvances écologiques. Ainsi, ces pratiques somatiques pourraient s'intégrer dans le développement d'une culture écologique, une culture de la soutenabilité. Cette notion fait référence à l'importance de la culture dans le processus de développement individuel, tant par le rôle constitutif qu'elle joue dans la construction des vies humaines que par le rôle participatif qu'elle tient dans les relations sociales et économiques. Or, la culture se tient au centre du principe de soutenabilité, puisque c'est par elle que notre rapport à la nature et à la communauté humaine se construit et s'opère.
Dans un tout autre contexte, les pratiques somatiques rĂ©pondent aux nouvelles missions des structures de soin ou d'accompagnement social - qualitĂ© de vie, Ă©ducation thĂ©rapeutique, « autonomie » des personnes en « situation de handicap », art thĂ©rapie... Alternatives ou complĂ©mentaires, elles s'imbriquent dans un modèle socio-Ă©conomique du soin en marge du « progrès techno-pharmaceutique » du modèle dominant. Ces pratiques proposent une co-construction du soin, voire de partage des responsabilitĂ©s : tandis que le praticien propose un soin basĂ© sur le toucher et le dialogue dans la durĂ©e, l'expertise du patient sur sa santĂ© y (re)trouve une place tant dans le diagnostic que dans le remède. Dans quelle mesure l'intĂ©gration de ces pratiques dans le monde du soin peut-elle participer d'un changement de paradigme qui, plutĂ´t que de travailler sur un corps-objet, introduirait d'emblĂ©e la question de la relation, du rapport avec le milieu, des manières de faire et de produire des champs d'expĂ©rience autres ? En ce sens, au-delĂ des singularitĂ©s de chaque mĂ©thode, les pratiques somatiques partagent un certain nombre de principes proposant une approche Ă©cologique et notamment leur apprĂ©hension holistique du sujet et de son environnement. En effet, elles proposent de mettre au cœur de leur approche les interactions nĂ©cessaires Ă la vie - que cet Ă©cosystème soit celui de l'individu (en tant que multiple) ou celui de l'homme et de son milieu, que ces interactions soient avec les humains, les non-humains ou encore les Ă©lĂ©ments. En cela les pratiques somatiques s'intègrent dans un paradigme Ă©cologique de la santĂ© et c'est cette possibilitĂ© de cadre thĂ©orique qu'il nous semble important de partager.
Pour cela nous avons conçu des journées d'échanges et de pratiques afin de construire des nouveaux espaces de réflexion autour des méthodes somatiques. Chaque journée sera consacrée à l'un des trois grands thèmes proposés : le soin, l'art et le politique - ce qui n'implique pas qu'il n'y ait pas de l'art dans le soin ou du soin dans l'art (et certainement du politique partout) mais que pour éclairer la proposition il nous faut d'abord l'effiler pour ensuite tisser une trame commune.
Chaque matinĂ©e sera rĂ©servĂ©e Ă 2 heures de pratiques, des pratiques somatiques bien Ă©videmment qui seront suivies d'une confĂ©rence plĂ©nière afin d'avoir un soma bouillant d'imagination et de propositions Ă partager lors d'un repas en commun. L'après-midi se consacrera Ă un premier temps d'exposĂ©s sur les liens entre Ă©cologie et somatique, invitant au dĂ©bat afin d'activer de nouveaux cadres conceptuels. Un deuxième temps consacrĂ© Ă des rĂ©cits d'expĂ©riences concrètes qui agissent au cœur de l'environnement social, physique, urbain... seront autant de manière de penser un mouvement qui nous fait traverser des « territoires », une manière de penser les transitions, les interactions.
Programme ci-joint
Comité organisateur :
Bottiglieri Carla (Université Paris 8)
Clavel Joanne (Université Paris 8, Muséum National d'Histoire Naturelle)
Ginot Isabelle (Université Paris 8)
Collectif Natural Movement
Comité scientifique
Bardet Marie (Université Paris 8, Université de Buenos Aires)
Bottiglieri Carla (Université Paris 8)
Clavel Joanne (Université Paris 8, Muséum National d'Histoire Naturelle)
Ginot Isabelle (Université Paris 8)
Salvatierra garcĂa de QuirĂłs Violetta (UniversitĂ© Paris 8)
ARCHIVES du colloque accessibles ici : http://natural-movement.fr/files/CONFERENCES/ecosomatiques/presentation.html
Les « pratiques somatiques » sont un ensemble de pratiques corporelles dont l'émergence en Occident commence au tournant du 20e siècle, et qui continuent à se développer jusqu'à aujourd'hui. Les initiateurs de ces méthodes argumentent le développement des méthodes d'éducation somatique comme une réponse directement issue des problèmes environnementaux causés par l'industrialisation grandissante des pays occidentaux et l'impact de ces changements sur les modes de vie (Gindler, Todd, Feldenkrais). L'urbanisation, les problèmes de pollutions, l'accélération des rythmes de vie et du rendement du travail modifient le quotidien des individus dont la qualité de vie en terme de corporéité se dégrade aussi vite que leur environnement. Dès ces débuts on peut proposer de construire une histoire de ces pratiques en regard d'une « contreculture verte », même si sa pratique actuelle en France, et dans l'ensemble des société post-industrielles, s'est normalisée au sein du vaste marché du « bien-être » récupérant au passage les pratiques corporelles orientales (yoga, taï-chi, qi qong...). En effet, les pratiques somatiques s'apparentent à ce qu'on pourrait appeler une « créativité environnementale » en réponse aux dégradations écologiques, dont il reste encore à cerner les modes de fonctionnement et le statut par rapport aux politiques publiques de soin, des loisirs et du monde des arts vivants.
Les pratiques somatiques ont connu un essor croissant dans le monde de l'art chorégraphique. Que les danseurs usent des somatiques à des fins purement techniques (efficacité et amplitude de mouvement), d'interprétation (gamme de nuances qualitatives du geste) ou encore personnelles (plaisir de se mettre en mouvement, de partager une pratique), tous veulent nourrir leurs connaissances par un ressenti interne reliant ainsi savoirs et savoir-faire. Combien, et comment, l'insertion des pratiques somatiques dans le champ chorégraphique vient-elle poser la question du rapport au monde, déplacer certaines approches de ce qu'il est difficile d'appeler « LE corps », ouvrir à un autre regard sur le rapport au milieu et aux autres ? En d'autres termes, en quoi peuvent-elles être vecteurs de questionnements politiques ? D'ailleurs, cet usage des danseurs est souvent à rapprocher de pratiques sociologiques plus globalement proches des mouvances écologiques. Ainsi, ces pratiques somatiques pourraient s'intégrer dans le développement d'une culture écologique, une culture de la soutenabilité. Cette notion fait référence à l'importance de la culture dans le processus de développement individuel, tant par le rôle constitutif qu'elle joue dans la construction des vies humaines que par le rôle participatif qu'elle tient dans les relations sociales et économiques. Or, la culture se tient au centre du principe de soutenabilité, puisque c'est par elle que notre rapport à la nature et à la communauté humaine se construit et s'opère.
Dans un tout autre contexte, les pratiques somatiques rĂ©pondent aux nouvelles missions des structures de soin ou d'accompagnement social - qualitĂ© de vie, Ă©ducation thĂ©rapeutique, « autonomie » des personnes en « situation de handicap », art thĂ©rapie... Alternatives ou complĂ©mentaires, elles s'imbriquent dans un modèle socio-Ă©conomique du soin en marge du « progrès techno-pharmaceutique » du modèle dominant. Ces pratiques proposent une co-construction du soin, voire de partage des responsabilitĂ©s : tandis que le praticien propose un soin basĂ© sur le toucher et le dialogue dans la durĂ©e, l'expertise du patient sur sa santĂ© y (re)trouve une place tant dans le diagnostic que dans le remède. Dans quelle mesure l'intĂ©gration de ces pratiques dans le monde du soin peut-elle participer d'un changement de paradigme qui, plutĂ´t que de travailler sur un corps-objet, introduirait d'emblĂ©e la question de la relation, du rapport avec le milieu, des manières de faire et de produire des champs d'expĂ©rience autres ? En ce sens, au-delĂ des singularitĂ©s de chaque mĂ©thode, les pratiques somatiques partagent un certain nombre de principes proposant une approche Ă©cologique et notamment leur apprĂ©hension holistique du sujet et de son environnement. En effet, elles proposent de mettre au cœur de leur approche les interactions nĂ©cessaires Ă la vie - que cet Ă©cosystème soit celui de l'individu (en tant que multiple) ou celui de l'homme et de son milieu, que ces interactions soient avec les humains, les non-humains ou encore les Ă©lĂ©ments. En cela les pratiques somatiques s'intègrent dans un paradigme Ă©cologique de la santĂ© et c'est cette possibilitĂ© de cadre thĂ©orique qu'il nous semble important de partager.
Pour cela nous avons conçu des journées d'échanges et de pratiques afin de construire des nouveaux espaces de réflexion autour des méthodes somatiques. Chaque journée sera consacrée à l'un des trois grands thèmes proposés : le soin, l'art et le politique - ce qui n'implique pas qu'il n'y ait pas de l'art dans le soin ou du soin dans l'art (et certainement du politique partout) mais que pour éclairer la proposition il nous faut d'abord l'effiler pour ensuite tisser une trame commune.
Chaque matinĂ©e sera rĂ©servĂ©e Ă 2 heures de pratiques, des pratiques somatiques bien Ă©videmment qui seront suivies d'une confĂ©rence plĂ©nière afin d'avoir un soma bouillant d'imagination et de propositions Ă partager lors d'un repas en commun. L'après-midi se consacrera Ă un premier temps d'exposĂ©s sur les liens entre Ă©cologie et somatique, invitant au dĂ©bat afin d'activer de nouveaux cadres conceptuels. Un deuxième temps consacrĂ© Ă des rĂ©cits d'expĂ©riences concrètes qui agissent au cœur de l'environnement social, physique, urbain... seront autant de manière de penser un mouvement qui nous fait traverser des « territoires », une manière de penser les transitions, les interactions.
Programme ci-joint
Relire les années 1970 (3) : les forces militantes - Institutionnalisation, syndicalisme [...]
23 mai 2014, Centre national de la danse
Titre complet : Relire les années 1970 (3) : les forces militantes - Institutionnalisation, syndicalisme et critique en danse.
Journée d'études organisée par Sylviane Pagès, Mélanie Papin et Guillaume Sintès du « Groupe de Recherche : Histoire Contemporaine du Champ Chorégraphique en France ».
Journée d'études organisée par Sylviane Pagès, Mélanie Papin et Guillaume Sintès du « Groupe de Recherche : Histoire Contemporaine du Champ Chorégraphique en France ».
Nexus Rainer
12 décembre 2014, Palais de Tokyo (Paris)
Colloque international
Responsables : Barbara Formis, Julie Perrin et Chantal Pontbriand
Avec : Emmanuel Alloa, Pauline Boudry, Yael Davids, Vanessa Desclaux, Barbara Formis, Myrto Katsiki, Isabelle Launay, Julie Pellegrin, Julie Perrin, Denis Pernet, Chantal Pontbriand, Catherine Queloz, Liliane Schneiter, Noé Soulier, David Zerbib.
Ce colloque international rĂ©unit lors d'une journĂ©e de rĂ©flexion diffĂ©rents chercheurs en art qui se sont intĂ©ressĂ©s de près Ă Yvonne Rainer, afin d'aborder les divers aspects de son œuvre et ses rĂ©sonances aujourd'hui dans l'art contemporain (chorĂ©graphie, art visuel ou cinĂ©ma) ou dans la recherche en art. C'est envisager tout autant Rainer comme chorĂ©graphe et danseuse, que la cinĂ©aste, la thĂ©oricienne de l'art (l'on songe aussi bien Ă ses Ă©crits sur la chorĂ©graphie que ceux sur le cinĂ©ma et le genre) ou encore l'Ă©crivain (elle est l'auteure d'une autobiographie et d'un recueil de poĂ©sie).
L'événement se tiendra à l'occasion de la présentation du Yvonne Rainer Project conçu par Chantal Pontbriand. Le colloque est co-organisé par Barbara FORMIS (maître de conférence en philosophie de l'art, université Paris 1), Julie PERRIN (enseignante-chercheuse au département danse de l'université Paris 8 Saint-Denis) et Chantal PONTBRIAND, avec le soutien de laboratoire d'analyse des discours et pratiques en danse (1572, université Paris 8).
Programme détaillé ci-joint.
Responsables : Barbara Formis, Julie Perrin et Chantal Pontbriand
Avec : Emmanuel Alloa, Pauline Boudry, Yael Davids, Vanessa Desclaux, Barbara Formis, Myrto Katsiki, Isabelle Launay, Julie Pellegrin, Julie Perrin, Denis Pernet, Chantal Pontbriand, Catherine Queloz, Liliane Schneiter, Noé Soulier, David Zerbib.
Ce colloque international rĂ©unit lors d'une journĂ©e de rĂ©flexion diffĂ©rents chercheurs en art qui se sont intĂ©ressĂ©s de près Ă Yvonne Rainer, afin d'aborder les divers aspects de son œuvre et ses rĂ©sonances aujourd'hui dans l'art contemporain (chorĂ©graphie, art visuel ou cinĂ©ma) ou dans la recherche en art. C'est envisager tout autant Rainer comme chorĂ©graphe et danseuse, que la cinĂ©aste, la thĂ©oricienne de l'art (l'on songe aussi bien Ă ses Ă©crits sur la chorĂ©graphie que ceux sur le cinĂ©ma et le genre) ou encore l'Ă©crivain (elle est l'auteure d'une autobiographie et d'un recueil de poĂ©sie).
L'événement se tiendra à l'occasion de la présentation du Yvonne Rainer Project conçu par Chantal Pontbriand. Le colloque est co-organisé par Barbara FORMIS (maître de conférence en philosophie de l'art, université Paris 1), Julie PERRIN (enseignante-chercheuse au département danse de l'université Paris 8 Saint-Denis) et Chantal PONTBRIAND, avec le soutien de laboratoire d'analyse des discours et pratiques en danse (1572, université Paris 8).
Programme détaillé ci-joint.
La « contemporanéité » dans les pratiques scéniques en danse et en musique [...]
26-27 septembre 2014, université de Nice Sofia-Antipolis
Titre complet : La « contemporanéité » dans les pratiques scéniques en danse et en musique : regards croisés entre l'Afrique et l'Asie du Sud
Colloque organisé par Antoine BOURGEAU (musicien, chargé de cours Université de Nice Sophia Antipolis), Federica FRATAGNOLI (maître de conférences Université de Nice Sophia Antipolis), Mahalia LASSIBILLE (maître de conférences Université Paris 8)
DĂ©tail ci-joint.
Colloque organisé par Antoine BOURGEAU (musicien, chargé de cours Université de Nice Sophia Antipolis), Federica FRATAGNOLI (maître de conférences Université de Nice Sophia Antipolis), Mahalia LASSIBILLE (maître de conférences Université Paris 8)
DĂ©tail ci-joint.
Petite université populaire de la danse 2012-2013
théâtre national de Chaillot, 3 conférences
Chaque saison depuis 2009, la petite université populaire de la danse, en partenariat avec le département danse de l'université Paris 8 et le musée du Louvre, se penche sur des verbes d'action - qui ne sont pas propres à la danse, et que chacun de nous connaît. Les chercheurs invités nous amènent à interroger ces actions, à comprendre ce qu'elles mettent en jeu, et à approcher l'histoire de la danse à partir de ces verbes...
Chacun de ces verbes d'action donne lieu à une conférence à Chaillot, suivie quelques jours plus tard d'un rendez-vous au Louvre.
Coordination : Marie Glon,doctorante à l'EHESS, ATER au dpt danse de l'université Paris 8, rédactrice en chef de la revue Repères, cahier de danse.
Apparaître : 17 novembre, par Mélanie Papin (à Chaillot)
Fuguer : 16 février, par Andrée Grau (à Chaillot)
Effacer : 6 avril, par Myrto Katsiki (Ă Chaillot)
Conférence suivie d'une séance au Louvre: 21 novembre 2012, 20 février 2013, 10 avril 2013. Parcours danse-arts plastiques conçu avec Laetitia Doat, dans le cadre de la Petite université populaire de la danse (organisé par le Théâtre National de Chaillot en partenariat avec le département Danse de Paris 8 et le Musée du Louvre).
Chacun de ces verbes d'action donne lieu à une conférence à Chaillot, suivie quelques jours plus tard d'un rendez-vous au Louvre.
Coordination : Marie Glon,doctorante à l'EHESS, ATER au dpt danse de l'université Paris 8, rédactrice en chef de la revue Repères, cahier de danse.
Apparaître : 17 novembre, par Mélanie Papin (à Chaillot)
Fuguer : 16 février, par Andrée Grau (à Chaillot)
Effacer : 6 avril, par Myrto Katsiki (Ă Chaillot)
Conférence suivie d'une séance au Louvre: 21 novembre 2012, 20 février 2013, 10 avril 2013. Parcours danse-arts plastiques conçu avec Laetitia Doat, dans le cadre de la Petite université populaire de la danse (organisé par le Théâtre National de Chaillot en partenariat avec le département Danse de Paris 8 et le Musée du Louvre).
Gestes et mouvements à l'oeuvre. Une question danse-musique, XXe-XXIe siècles
Colloque, Université Paris 8 . Les 17 et 18 janvier 2013
Colloque international et transdisciplinaire,organisé par :
Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Laboratoire d'études et de recherche sur les Logiques Contemporaines de la Pensée (EA4008).
Laboratoire d'esthétique, musicologie et créations musicales (EA1572).
Laboratoire d'analyse des discours et pratiques en danse (sous-section d'EA1572).
Unité de recherches Philosophies Contemporaines (EA 3562), Centre d'Esthétique et de Philosophie de l'Art.
Sous la direction d'Olga Moll, Pauline Nadrigny, Christine Roquet et Katharina Van Dyk
Programme détaillé ci-joint.
Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Laboratoire d'études et de recherche sur les Logiques Contemporaines de la Pensée (EA4008).
Laboratoire d'esthétique, musicologie et créations musicales (EA1572).
Laboratoire d'analyse des discours et pratiques en danse (sous-section d'EA1572).
Unité de recherches Philosophies Contemporaines (EA 3562), Centre d'Esthétique et de Philosophie de l'Art.
Sous la direction d'Olga Moll, Pauline Nadrigny, Christine Roquet et Katharina Van Dyk
Programme détaillé ci-joint.
Relire les années 70 (1). Les corporéités dansantes en France [...]
Journée d'étude, 13 avril 2013, BnF - Site Richelieu, Salle des commissions
Titre complet : Relire les années 70. Les corporéités dansantes en France à partir de l'expérience des danseurs
Journée d'études organisée par le « Groupe de Recherche : Histoire Contemporaine du Champ Chorégraphique en France » avec le soutien du Laboratoire « Analyse des discours et des pratiques en danse » (EA 1572 Esthétique, musicologie, danse et créations musicales, Université Paris VIII) et en partenariat avec le Département des Arts du Spectacle de la Bibliothèque nationale de France.
Après une première journée de réflexion consacrée à la danse en mai 68 (Micadanses, octobre 2012), notre relecture des années 1970 se poursuit en invitant des danseurs et chorégraphes à partager les pratiques qui oeuvraient dans les studios à cette époque.
Il s'agit d'interroger et d'affiner notre regard sur la pluralité des corporéités dansantes, issues de la danse moderne, abstraite ou afro-américaine et qui se sont déployées aussi bien dans les institutions (GRTOP...) que dans le tissu associatif émergeant (Danse Théâtre Expérience, Free Dance Song...).
Partir des savoir-faire des danseurs implique la présentation de séquences dansées, qui seront mises en dialogue avec les chercheurs.
Programme détaillé ci-joint.
Journée d'études organisée par le « Groupe de Recherche : Histoire Contemporaine du Champ Chorégraphique en France » avec le soutien du Laboratoire « Analyse des discours et des pratiques en danse » (EA 1572 Esthétique, musicologie, danse et créations musicales, Université Paris VIII) et en partenariat avec le Département des Arts du Spectacle de la Bibliothèque nationale de France.
Après une première journée de réflexion consacrée à la danse en mai 68 (Micadanses, octobre 2012), notre relecture des années 1970 se poursuit en invitant des danseurs et chorégraphes à partager les pratiques qui oeuvraient dans les studios à cette époque.
Il s'agit d'interroger et d'affiner notre regard sur la pluralité des corporéités dansantes, issues de la danse moderne, abstraite ou afro-américaine et qui se sont déployées aussi bien dans les institutions (GRTOP...) que dans le tissu associatif émergeant (Danse Théâtre Expérience, Free Dance Song...).
Partir des savoir-faire des danseurs implique la présentation de séquences dansées, qui seront mises en dialogue avec les chercheurs.
Programme détaillé ci-joint.
Relire les années 1970 (2) : les circulations chorégraphiques en France
Vendredi 6 décembre 2013 11h - 18h Théâtre de la Cité Internationale
Journée d'études organisée par Sylviane Pagès, Mélanie Papin et Guillaume Sintès.
Après une journée sur la danse en mai 68 (Micadanses, octobre 2012), et une consacrée aux grands studios (BnF, avril 2013), le cycle « Relire les années 1970 » se poursuit sous l'angle des circulations chorégraphiques internationales.
Cette décennie d'intenses mutations du champ chorégraphique contemporain connaît de nombreux échanges, tournés principalement vers les États-Unis, mais aussi l'Afrique, l'Inde ou le Japon. Plusieurs études de cas - l'arrivée du contact-improvisation, les directions américaines au Cndc, William Forsythe, Matt Mattox, Elsa Wolliaston...-, permettront d'analyser les désirs d'ailleurs qui traversent le champ de la danse : Quels nouveaux gestes ont été accueillis ? De quelles Amériques le champ de la danse s'est-il emparé ? Quelles ont été les fonctions de l'autre : exotisme, bouleversement perceptif, recherche de modèle, quête identitaire ? De nouveaux chantiers de recherche et des témoignages tenteront de décentrer l'histoire de la danse, en l'approchant par ses moments de rencontre avec l'autre.
Intervenants : Lucile Goupillon, Aline Laignel, Gérard Mayen, Sylviane Pagès, interview filmée d'Elsa Wolliaston, intervention dansée de Didier Silhol.
Journée d'études organisée par le « Groupe de Recherche : Histoire Contemporaine du Champ Chorégraphique en France » avec le soutien du Laboratoire « Analyse des discours et des pratiques en danse » (EA 1572 Esthétique, musicologie, danse et créations musicales, Université Paris VIII) et en partenariat avec le Théâtre de la Cité Internationale.
Après une journée sur la danse en mai 68 (Micadanses, octobre 2012), et une consacrée aux grands studios (BnF, avril 2013), le cycle « Relire les années 1970 » se poursuit sous l'angle des circulations chorégraphiques internationales.
Cette décennie d'intenses mutations du champ chorégraphique contemporain connaît de nombreux échanges, tournés principalement vers les États-Unis, mais aussi l'Afrique, l'Inde ou le Japon. Plusieurs études de cas - l'arrivée du contact-improvisation, les directions américaines au Cndc, William Forsythe, Matt Mattox, Elsa Wolliaston...-, permettront d'analyser les désirs d'ailleurs qui traversent le champ de la danse : Quels nouveaux gestes ont été accueillis ? De quelles Amériques le champ de la danse s'est-il emparé ? Quelles ont été les fonctions de l'autre : exotisme, bouleversement perceptif, recherche de modèle, quête identitaire ? De nouveaux chantiers de recherche et des témoignages tenteront de décentrer l'histoire de la danse, en l'approchant par ses moments de rencontre avec l'autre.
Intervenants : Lucile Goupillon, Aline Laignel, Gérard Mayen, Sylviane Pagès, interview filmée d'Elsa Wolliaston, intervention dansée de Didier Silhol.
Journée d'études organisée par le « Groupe de Recherche : Histoire Contemporaine du Champ Chorégraphique en France » avec le soutien du Laboratoire « Analyse des discours et des pratiques en danse » (EA 1572 Esthétique, musicologie, danse et créations musicales, Université Paris VIII) et en partenariat avec le Théâtre de la Cité Internationale.
Petite université populaire de la danse 2011-2012
Théâtre national de Chaillot, 5 conférences
Pour la troisième saison, le Théâtre National de Chaillot, en partenariat avec le département danse de l'université Paris 8 et le musée du Louvre, propose un cycle de conférences sur la danse. Ces conférences s'adressent aussi bien aux néophytes qu'aux « savants » : elles invitent à ouvrir notre perception de l'art chorégraphique, en explorant différentes façons de parler de la danse.
Ce cycle s'organise autour de verbes d'action. En 2009/2010, nous avions choisi ĂŞtre debout, tomber, tourner, sauter, marcher, en 2010/2011 s'asseoir, porter, arriver/partir, prendre par la main, courir.
En 2011/2012, la rĂ©flexion se poursuit autour de regarder, frapper, rassembler, installer, glisser : avec chacun de ces thèmes, il s'agit d'Ă©voquer l'histoire des reprĂ©sentations du corps en mouvement, en recourant Ă l'analyse du mouvement et d'œuvres chorĂ©graphiques, Ă la philosophie, Ă l'histoire ou Ă d'autres Ă©clairages issus des sciences humaines et des savoir faire des danseurs. Chacun de ces verbes d'action donne lieu Ă une confĂ©rence au Théâtre National de Chaillot, suivie quelques jours plus tard d'un rendez-vous au musĂ©e du Louvre : animĂ©e par deux chercheuses en danse, cette visite invite les participants Ă cheminer entre danse et arts plastiques.
- Regarder, par Isabelle Ginot le 15 octobre, (Louvre 19/10 et 21/10 par L. Doat et M. Glon)
- Frapper, par Federica Fratagnoli le 19 novembre (Louvre 23 et 30)
- Rassembler, par Claude Sorin le 14 janvier (Louvre 18 et 25)
- Installer, par Barbara Formis le 11 février (Louvre 15/02 et 7/03)
- Glisser, par Julie Perrin le 10 mars (Louvre 14 et 21)
Coordination Marie Glon, doctorante à l'EHESS, rédactrice en chef de la revue Repères, cahier de danse.
Ce cycle s'organise autour de verbes d'action. En 2009/2010, nous avions choisi ĂŞtre debout, tomber, tourner, sauter, marcher, en 2010/2011 s'asseoir, porter, arriver/partir, prendre par la main, courir.
En 2011/2012, la rĂ©flexion se poursuit autour de regarder, frapper, rassembler, installer, glisser : avec chacun de ces thèmes, il s'agit d'Ă©voquer l'histoire des reprĂ©sentations du corps en mouvement, en recourant Ă l'analyse du mouvement et d'œuvres chorĂ©graphiques, Ă la philosophie, Ă l'histoire ou Ă d'autres Ă©clairages issus des sciences humaines et des savoir faire des danseurs. Chacun de ces verbes d'action donne lieu Ă une confĂ©rence au Théâtre National de Chaillot, suivie quelques jours plus tard d'un rendez-vous au musĂ©e du Louvre : animĂ©e par deux chercheuses en danse, cette visite invite les participants Ă cheminer entre danse et arts plastiques.
- Regarder, par Isabelle Ginot le 15 octobre, (Louvre 19/10 et 21/10 par L. Doat et M. Glon)
- Frapper, par Federica Fratagnoli le 19 novembre (Louvre 23 et 30)
- Rassembler, par Claude Sorin le 14 janvier (Louvre 18 et 25)
- Installer, par Barbara Formis le 11 février (Louvre 15/02 et 7/03)
- Glisser, par Julie Perrin le 10 mars (Louvre 14 et 21)
Coordination Marie Glon, doctorante à l'EHESS, rédactrice en chef de la revue Repères, cahier de danse.
Danser en mai 68
Journée de réflexion à Micadanses, Paris. Le 24 octobre 2012
Journée de réflexion organisée le Groupe de recherche en histoire contemporaine du champ chorégraphique en France (Université Paris VIII - Département Danse - Laboratoire des pratiques et des discours du champ chorégraphique)en partenariat avec Micadanses
Programme détaillé ci-joint.
Programme détaillé ci-joint.
Projet de recherche : La critique en action : regards de l'art et regards sur l'art / Festival CRITIQUES
Du 5 au 7 décembre 2012, au CNDC d'Angers
Projet de recherche dirigé par Isabelle Ginot, Emmanuelle Huynh et Anne Kerzerho.
Coordonné par Myrto Katsiki, Jennifer Lacey et Ninon Prouteau
Date : 2012.
Ce projet intitulé "La critique en action : regards de l'art et regards sur l'art" réunit trois partenaires :
- Laboratoire d'analyse des discours et pratiques en danse, Université Paris 8
- Centre national de danse contemporaine d'Angers (direction Emmanuelle Huynh) : École supérieure de danse contemporaine (Formation Essais - Master « Création et Performance)
- ESBA TALM (École supérieure des Beaux-Arts d'Angers)
Il a reçu le soutien du Labex Arts - H2H (2012)
Programme détaillé du Festival CRITIQUES, ci-joint.
Depuis les annĂ©es 1990, nombreux sont les artistes chorĂ©graphiques Ă mettre en place des dispositifs critiques, soit au sein de leur travail de crĂ©ation, soit dans les mĂ©dias traditionnellement rĂ©servĂ©s Ă la critique : les artistes investissent la presse spĂ©cialisĂ©e (notamment Art Press et Mouvement, Movement Research, Contact Quarterly), ou encore des sites internet tels que www.everybodystoolbox.net, www.countercritic.com) pour y commenter leurs propres œuvres et celles de leurs pairs ; ces mĂŞmes artistes mettent en scène les corps des critiques ou des chercheurs ainsi que leurs discours (Alain Buffard ou CĂ©cile Proust avec Laurence Louppe, Latifa Laâbissi avec Isabelle Launay, Boris Charmatz avec Hubert Godard et Isabelle Launay etc.) ; diffĂ©rents dispositifs performatifs et discursifs conduisent Ă partager publiquement une critique d'art qui s'invente en direct et s'Ă©prouve dans le dialogue immĂ©diat avec le public (le dispositif des Commentaires suivis de Bojana Cvejic, les diffĂ©rents jeux proposĂ©s lors de l'Edition SpĂ©ciale#0 par les Laboratoires d'Aubervilliers en 2011, ou encore le projet danse dĂ©veloppĂ© par Rosalind Crisp et Isabelle Ginot depuis 2005, etc.).
On assiste ainsi à l'émergence d'un spectre de pratiques - des conférences dansées aux critiques performées - qui opèrent une diversification des rapports danse/critique : à l'activité classique de la critique sur l'art, s'ajoute la pratique critique par les artistes, les critiques performatives (ou écritures et performances sur l'art pratiquées par les critiques), et enfin, le discours critique comme objet de l'art ou performance critique.
Ce projet vise Ă observer et analyser la « critique en action » sous toutes ses formes, du point de vue de ses processus et mĂ©thodologies. Il s'agira Ă©galement de mettre en œuvre des mĂ©thodologies de travail innovants associant chercheurs et artistes, afin d'une part de revisiter l'approche universitaire de la question critique, et d'autre part de prendre en compte la nouvelle place que cette question occupe dĂ©sormais au sein des pratiques artistiques elles-mĂŞmes.
Objectifs :
- réaliser un état des lieux, une « cartographie », de différents objets de la critique performative en danse et effectuer un travail d'analyse du point de vue de ses processus et méthodologies
- interroger les perspectives pédagogiques offertes par l'approche de la critique performative ; mettre en place une modalité d'échange et de travail avec les étudiants de la formation Essais, Master « Création et Performance », CNDC d'Angers
- concevoir un format innovant de présentation/activation des résultats du projet (du 5 au 7 décembre 2012, CNDC d'Angers) en s'appuyant sur l'analyse des méthodologies de production/création critique collectées tout au long des recherches
Coordonné par Myrto Katsiki, Jennifer Lacey et Ninon Prouteau
Date : 2012.
Ce projet intitulé "La critique en action : regards de l'art et regards sur l'art" réunit trois partenaires :
- Laboratoire d'analyse des discours et pratiques en danse, Université Paris 8
- Centre national de danse contemporaine d'Angers (direction Emmanuelle Huynh) : École supérieure de danse contemporaine (Formation Essais - Master « Création et Performance)
- ESBA TALM (École supérieure des Beaux-Arts d'Angers)
Il a reçu le soutien du Labex Arts - H2H (2012)
Programme détaillé du Festival CRITIQUES, ci-joint.
Depuis les annĂ©es 1990, nombreux sont les artistes chorĂ©graphiques Ă mettre en place des dispositifs critiques, soit au sein de leur travail de crĂ©ation, soit dans les mĂ©dias traditionnellement rĂ©servĂ©s Ă la critique : les artistes investissent la presse spĂ©cialisĂ©e (notamment Art Press et Mouvement, Movement Research, Contact Quarterly), ou encore des sites internet tels que www.everybodystoolbox.net, www.countercritic.com) pour y commenter leurs propres œuvres et celles de leurs pairs ; ces mĂŞmes artistes mettent en scène les corps des critiques ou des chercheurs ainsi que leurs discours (Alain Buffard ou CĂ©cile Proust avec Laurence Louppe, Latifa Laâbissi avec Isabelle Launay, Boris Charmatz avec Hubert Godard et Isabelle Launay etc.) ; diffĂ©rents dispositifs performatifs et discursifs conduisent Ă partager publiquement une critique d'art qui s'invente en direct et s'Ă©prouve dans le dialogue immĂ©diat avec le public (le dispositif des Commentaires suivis de Bojana Cvejic, les diffĂ©rents jeux proposĂ©s lors de l'Edition SpĂ©ciale#0 par les Laboratoires d'Aubervilliers en 2011, ou encore le projet danse dĂ©veloppĂ© par Rosalind Crisp et Isabelle Ginot depuis 2005, etc.).
On assiste ainsi à l'émergence d'un spectre de pratiques - des conférences dansées aux critiques performées - qui opèrent une diversification des rapports danse/critique : à l'activité classique de la critique sur l'art, s'ajoute la pratique critique par les artistes, les critiques performatives (ou écritures et performances sur l'art pratiquées par les critiques), et enfin, le discours critique comme objet de l'art ou performance critique.
Ce projet vise Ă observer et analyser la « critique en action » sous toutes ses formes, du point de vue de ses processus et mĂ©thodologies. Il s'agira Ă©galement de mettre en œuvre des mĂ©thodologies de travail innovants associant chercheurs et artistes, afin d'une part de revisiter l'approche universitaire de la question critique, et d'autre part de prendre en compte la nouvelle place que cette question occupe dĂ©sormais au sein des pratiques artistiques elles-mĂŞmes.
Objectifs :
- réaliser un état des lieux, une « cartographie », de différents objets de la critique performative en danse et effectuer un travail d'analyse du point de vue de ses processus et méthodologies
- interroger les perspectives pédagogiques offertes par l'approche de la critique performative ; mettre en place une modalité d'échange et de travail avec les étudiants de la formation Essais, Master « Création et Performance », CNDC d'Angers
- concevoir un format innovant de présentation/activation des résultats du projet (du 5 au 7 décembre 2012, CNDC d'Angers) en s'appuyant sur l'analyse des méthodologies de production/création critique collectées tout au long des recherches
Les lieux de l'art
Forum de la Semaine des Arts 2012 (2e édition), 29 mars 2012, amphi X, Université Paris 8
Coordination : Julie Perrin
Participants : Isabelle Ginot, enseignante Danse Paris 8 ; Robert Milin, artiste plasticien, enseignant à l'ENSA de Dijon ; Julie Perrin, enseignante Danse Paris 8 ; Laurent Pichaud, chorégraphe, Artiste Associé du Master études chorégraphiques de Montpellier pour 2011-13 ; Geneviève Schwoebel, artiste et enseignante Théâtre Paris 8 ; Anne Volvey, enseignante en Géographie, Université d'Artois.
La question des lieux de l'art engage artistes comme chercheurs dans une rĂ©flexion tant esthĂ©tique que politique. Elle soulève diverses strates d'interrogation quant aux conditions d'exposition des œuvres, au public auxquelles elles s'adressent, aux contextes physiques, sociaux, historiques avec lesquels elles dialoguent et se construisent. Interroger le geste artistique depuis la question du lieu, c'est un moyen d'Ă©changer entre disciplines sur nos recherches et pratiques, et de mettre en perspective les nombreuses propositions in situ de la Semaine des Arts.
En ligne ici http://www-artweb.univ-paris8.fr/?Lieux-de-l-art
Participants : Isabelle Ginot, enseignante Danse Paris 8 ; Robert Milin, artiste plasticien, enseignant à l'ENSA de Dijon ; Julie Perrin, enseignante Danse Paris 8 ; Laurent Pichaud, chorégraphe, Artiste Associé du Master études chorégraphiques de Montpellier pour 2011-13 ; Geneviève Schwoebel, artiste et enseignante Théâtre Paris 8 ; Anne Volvey, enseignante en Géographie, Université d'Artois.
La question des lieux de l'art engage artistes comme chercheurs dans une rĂ©flexion tant esthĂ©tique que politique. Elle soulève diverses strates d'interrogation quant aux conditions d'exposition des œuvres, au public auxquelles elles s'adressent, aux contextes physiques, sociaux, historiques avec lesquels elles dialoguent et se construisent. Interroger le geste artistique depuis la question du lieu, c'est un moyen d'Ă©changer entre disciplines sur nos recherches et pratiques, et de mettre en perspective les nombreuses propositions in situ de la Semaine des Arts.
En ligne ici http://www-artweb.univ-paris8.fr/?Lieux-de-l-art
Danse et littérature : usages de la métaphore
Journées d'étude, Vendredi 13 mai 2011, Maison de la recherche de l'Université de la Sorbonne-Paris IV ; Samedi 14 mai 2011, Université de Saint-Denis-Paris VIII
Journées d'études interdisciplinaires organisées avec le soutien de l'équipe « littératures françaises du XXe siècle » (EA 2577) de Paris IV et des équipes « littérature et histoires » (EA 1579) et « esthétique, musicologie et créations musicales » (EA1572 / laboratoire d'analyse des discours et pratiques du champ chorégraphique) de Paris VIII.
Ces journées d'étude sont nées du projet de croiser les domaines de la danse et de la littérature, en suscitant des échanges entre doctorants ou jeunes chercheurs des deux disciplines. Nous proposons ainsi de choisir la métaphore comme point de ralliement et de nous interroger sur le processus métaphorique, employé et valorisé par des discours aux statuts et contextes si variés, du roman aux studios de danse.
Dans la mesure où elle se fonde sur le « rapprochement de deux éléments hétérogènes » (Nanine Charbonnel), la métaphore semble à même de révéler les ressemblances de la littérature et de la danse, sans gommer l'irréductible dissemblance du corps et du verbe. Partant du constat qu'elle est en effet souvent convoquée quand il s'agit d'analyser les relations qu'entretiennent la danse et la littérature mais que son usage et sa pertinence ont été peu interrogés, nous proposons de réfléchir aux présupposés et aux enjeux de sa présence au carrefour de ces deux disciplines.
Précisons toutefois que, si la métaphore est très employée dans la critique comme dans la pratique chorégraphique, la recherche en danse est loin de l'avoir « absorbée » au point d'en faire un objet de prédilection théorique, comme c'est le cas des études littéraires et stylistiques. Nous faisons ainsi le pari que la confrontation de deux disciplines n'ayant pas emprunté les mêmes chemins théoriques peut permettre de renouveler l'appréhension du phénomène métaphorique, y compris en littérature. D'autre part, analyser l'usage en danse d'un outil du discours rhétorique et littéraire nous permettra d'envisager l'articulation avec la littérature sous l'angle peu étudié de la pratique chorégraphique.
Pauline Galli (allocataire-monitrice, littérature française, Paris VIII)
Delphine Vernozy (doctorante contractuelle, littérature française, Paris IV)
Bojana Bauer (doctorante, danse, Paris VIII)
Ninon Prouteau (doctorante contractuelle, danse, Paris VIII)
Pour plus d'informations, Ă©crivez-nous Ă l'adresse suivante : danselitterature@gmail.com
Ces journées d'étude sont nées du projet de croiser les domaines de la danse et de la littérature, en suscitant des échanges entre doctorants ou jeunes chercheurs des deux disciplines. Nous proposons ainsi de choisir la métaphore comme point de ralliement et de nous interroger sur le processus métaphorique, employé et valorisé par des discours aux statuts et contextes si variés, du roman aux studios de danse.
Dans la mesure où elle se fonde sur le « rapprochement de deux éléments hétérogènes » (Nanine Charbonnel), la métaphore semble à même de révéler les ressemblances de la littérature et de la danse, sans gommer l'irréductible dissemblance du corps et du verbe. Partant du constat qu'elle est en effet souvent convoquée quand il s'agit d'analyser les relations qu'entretiennent la danse et la littérature mais que son usage et sa pertinence ont été peu interrogés, nous proposons de réfléchir aux présupposés et aux enjeux de sa présence au carrefour de ces deux disciplines.
Précisons toutefois que, si la métaphore est très employée dans la critique comme dans la pratique chorégraphique, la recherche en danse est loin de l'avoir « absorbée » au point d'en faire un objet de prédilection théorique, comme c'est le cas des études littéraires et stylistiques. Nous faisons ainsi le pari que la confrontation de deux disciplines n'ayant pas emprunté les mêmes chemins théoriques peut permettre de renouveler l'appréhension du phénomène métaphorique, y compris en littérature. D'autre part, analyser l'usage en danse d'un outil du discours rhétorique et littéraire nous permettra d'envisager l'articulation avec la littérature sous l'angle peu étudié de la pratique chorégraphique.
Pauline Galli (allocataire-monitrice, littérature française, Paris VIII)
Delphine Vernozy (doctorante contractuelle, littérature française, Paris IV)
Bojana Bauer (doctorante, danse, Paris VIII)
Ninon Prouteau (doctorante contractuelle, danse, Paris VIII)
Pour plus d'informations, Ă©crivez-nous Ă l'adresse suivante : danselitterature@gmail.com
Éducation somatique thérapeutique et/ou thérapie éducative?
Sous titre : Le Body-Mind Centering® et le courant somatique entre éducation et thérapie? Conférence co-organisée avec l'association SOMA et Contredanse, 12-13 juin 2010
A l'occasion de la venue à Paris de Bonnie Bainbridge Cohen, fondatrice du Body-Mind Centering, cette conférence rassemblait théoriciens et praticiens somatiques et combinait ateliers et présentations orales. Voir programme ci-joint.
Petite université populaire de la danse 2010-2011
Théâtre national de Chaillot, 5 conférences
Le théâtre national de Chaillot, le département danse de l'Université Paris 8 et le musée du Louvre proposent un cycle de conférences sur la danse. Ces conférences s'adressent aussi bien aux néophytes qu'aux « connaisseurs » : elles invitent à ouvrir notre perception de l'art chorégraphique, en explorant différentes façons de parler de la danse.
Ce cycle s'organise autour de verbes d'action. En 2009-2010, nous avions choisi ĂŞtre debout, tomber, tourner, sauter, marcher. En 2010-2011, la rĂ©flexion se poursuit autour de s'asseoir, porter, arriver/partir, prendre par la main, courir : avec chacun de ces thèmes, il s'agit d'Ă©voquer l'histoire des reprĂ©sentations du corps en mouvement, en recourant Ă l'analyse du mouvement et d'œuvres chorĂ©graphiques, Ă la philosophie, Ă l'histoire ou Ă d'autres Ă©clairages issus des sciences humaines et des savoir-faire des danseurs.
Chacun de ces verbes d'action donne lieu à une conférence au Théâtre National de Chaillot, suivie quelques jours plus tard d'un rendez-vous au musée du Louvre : animée par deux chercheuses en danse, cette visite invite les participants à cheminer entre danse et arts plastiques.
Coordination Marie Glon, doctorante à l'EHESS, rédactrice en chef de la revue Repères, cahier de danse
En partenariat avec le département danse de l'Université Paris 8 et le musée du Louvre
. À Chaillot > les samedis 23 octobre, 27 novembre, 5 février, 19 mars et
30 avril Ă 17h
. Au Louvre > les mercredis 27 octobre, 1er décembre, 9 février, 23 mars et
11 mai Ă 19h
ATTENTION : Entrée libre dans la limite des places disponibles - réservation obligatoire au 01 53 65 30 00
INFO : http://theatre-chaillot.fr/lart-detre-spectateur
Petite université populaire de la danse, saison 2010/11
- S'asseoir :
23 octobre, conférence avec Isabelle Ginot au Théâtre National de Chaillot (17h-19h)
27 et 29 octobre, visite avec Laetitia Doat et Marie Glon au musée du Louvre (19h-21h)
- Prendre par la main :
27 novembre, conférence avec Marina Nordera au Théâtre National de Chaillot (14h30-16h30)
1er et 8 décembre, visite avec Laetitia Doat et Marie Glon au Musée du Louvre (19h-21h)
- Porter :
5 février, conférence avec Christine Roquet au Théâtre National de Chaillot (17h-19h)
9 et 11 février, visite avec Laetitia Doat et Marie Glon au Musée du Louvre (19h-21h)
- Arriver/partir :
19 mars, conférence avec Mahalia Lassibile au Théâtre National de Chaillot (17h-19h)
23 et 30 mars, visite avec Laetitia Doat et Marie Glon au Musée du Louvre (19h-21h)
- Courir :
30 avril, conférence avec Federica Fratagnoli au Théâtre National de Chaillot (17h-19h)
11 et 13 mai, visite avec Laetitia Doat et Marie Glon au Musée du Louvre (19h-21h)
Ce cycle s'organise autour de verbes d'action. En 2009-2010, nous avions choisi ĂŞtre debout, tomber, tourner, sauter, marcher. En 2010-2011, la rĂ©flexion se poursuit autour de s'asseoir, porter, arriver/partir, prendre par la main, courir : avec chacun de ces thèmes, il s'agit d'Ă©voquer l'histoire des reprĂ©sentations du corps en mouvement, en recourant Ă l'analyse du mouvement et d'œuvres chorĂ©graphiques, Ă la philosophie, Ă l'histoire ou Ă d'autres Ă©clairages issus des sciences humaines et des savoir-faire des danseurs.
Chacun de ces verbes d'action donne lieu à une conférence au Théâtre National de Chaillot, suivie quelques jours plus tard d'un rendez-vous au musée du Louvre : animée par deux chercheuses en danse, cette visite invite les participants à cheminer entre danse et arts plastiques.
Coordination Marie Glon, doctorante à l'EHESS, rédactrice en chef de la revue Repères, cahier de danse
En partenariat avec le département danse de l'Université Paris 8 et le musée du Louvre
. À Chaillot > les samedis 23 octobre, 27 novembre, 5 février, 19 mars et
30 avril Ă 17h
. Au Louvre > les mercredis 27 octobre, 1er décembre, 9 février, 23 mars et
11 mai Ă 19h
ATTENTION : Entrée libre dans la limite des places disponibles - réservation obligatoire au 01 53 65 30 00
INFO : http://theatre-chaillot.fr/lart-detre-spectateur
Petite université populaire de la danse, saison 2010/11
- S'asseoir :
23 octobre, conférence avec Isabelle Ginot au Théâtre National de Chaillot (17h-19h)
27 et 29 octobre, visite avec Laetitia Doat et Marie Glon au musée du Louvre (19h-21h)
- Prendre par la main :
27 novembre, conférence avec Marina Nordera au Théâtre National de Chaillot (14h30-16h30)
1er et 8 décembre, visite avec Laetitia Doat et Marie Glon au Musée du Louvre (19h-21h)
- Porter :
5 février, conférence avec Christine Roquet au Théâtre National de Chaillot (17h-19h)
9 et 11 février, visite avec Laetitia Doat et Marie Glon au Musée du Louvre (19h-21h)
- Arriver/partir :
19 mars, conférence avec Mahalia Lassibile au Théâtre National de Chaillot (17h-19h)
23 et 30 mars, visite avec Laetitia Doat et Marie Glon au Musée du Louvre (19h-21h)
- Courir :
30 avril, conférence avec Federica Fratagnoli au Théâtre National de Chaillot (17h-19h)
11 et 13 mai, visite avec Laetitia Doat et Marie Glon au Musée du Louvre (19h-21h)
Petite université populaire de la danse 2009-2010
2009-2010 : cinq rendez-vous, au Théâtre National de Chaillot et au Musée du Louvre
Ce cycle de confĂ©rences, qui s'adresse aussi bien aux nĂ©ophytes qu'aux « connaisseurs », invitait Ă ouvrir notre perception de l'art chorĂ©graphique en explorant diffĂ©rentes façons de parler de la danse. Chaque confĂ©rence s'organisait Ă partir d'un geste simple : ĂŞtre debout, marcher, tomber, sauter, tourner... Il s'agissait d'Ă©voquer l'histoire de nos reprĂ©sentations du corps en mouvement, en recourant Ă l'analyse du mouvement, Ă l'analyse d'œuvres chorĂ©graphiques, Ă la philosophie, Ă l'histoire ou Ă d'autres Ă©clairages issus des sciences humaines et des savoir-faire des danseurs.
En Ă©cho Ă chacune des confĂ©rences organisĂ©es au Théâtre National de Chaillot, un rendez-vous Ă©tait proposĂ© au musĂ©e du Louvre : deux chercheuses en danse ont Ă©laborĂ© avec le musĂ©e un parcours inĂ©dit au fil duquel elles porteront sur les œuvres plastiques un regard attentif au corps et au mouvement.
Coordination Marie Glon, doctorante à l'EHESS et rédactrice en chef de la revue « Repères, cahier de danse »
En partenariat avec le Département danse de l'Université Paris 8 et le musée du Louvre
Calendrier
Au Théâtre National de Chaillot
- samedi 7 novembre 2009 à 17h : Christine Roquet (maître de conférences à Paris 8, danse) > être debout
- samedi 30 janvier 2010 à 17h : Sylviane Pagès (docteur de l'université Paris 8, danse) > tomber
- samedi 13 mars 2010, 17h : Sophie Jacotot (docteur de l'université Paris 1, histoire) > tourner
- samedi 10 avril 2010, 17h : Isabelle Launay (professeur Ă Paris 8, danse) > sauter
- samedi 5 juin 2010, 17h : Marie Bardet (docteur de l'université Paris 8 et de l'université de Buenos Aires, philosophie) > marcher
Au Musée du Louvre
Visites guidées par Laetitia Doat (doctorante au Département danse de l'Université Paris 8) et Marie Glon (doctorante en histoire à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)
- mercredi 18 novembre 2009 de 19h Ă 21h > ĂŞtre debout
- mercredi 10 février 2010 de 19h à 21h > tomber
- mercredi 31 mars 2010 de 19h Ă 21h > tourner
- mercredi 14 avril 2010 de 19h Ă 21h > sauter
- mercredi 16 juin 2010 de 19h Ă 21h > marcher
En Ă©cho Ă chacune des confĂ©rences organisĂ©es au Théâtre National de Chaillot, un rendez-vous Ă©tait proposĂ© au musĂ©e du Louvre : deux chercheuses en danse ont Ă©laborĂ© avec le musĂ©e un parcours inĂ©dit au fil duquel elles porteront sur les œuvres plastiques un regard attentif au corps et au mouvement.
Coordination Marie Glon, doctorante à l'EHESS et rédactrice en chef de la revue « Repères, cahier de danse »
En partenariat avec le Département danse de l'Université Paris 8 et le musée du Louvre
Calendrier
Au Théâtre National de Chaillot
- samedi 7 novembre 2009 à 17h : Christine Roquet (maître de conférences à Paris 8, danse) > être debout
- samedi 30 janvier 2010 à 17h : Sylviane Pagès (docteur de l'université Paris 8, danse) > tomber
- samedi 13 mars 2010, 17h : Sophie Jacotot (docteur de l'université Paris 1, histoire) > tourner
- samedi 10 avril 2010, 17h : Isabelle Launay (professeur Ă Paris 8, danse) > sauter
- samedi 5 juin 2010, 17h : Marie Bardet (docteur de l'université Paris 8 et de l'université de Buenos Aires, philosophie) > marcher
Au Musée du Louvre
Visites guidées par Laetitia Doat (doctorante au Département danse de l'Université Paris 8) et Marie Glon (doctorante en histoire à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)
- mercredi 18 novembre 2009 de 19h Ă 21h > ĂŞtre debout
- mercredi 10 février 2010 de 19h à 21h > tomber
- mercredi 31 mars 2010 de 19h Ă 21h > tourner
- mercredi 14 avril 2010 de 19h Ă 21h > sauter
- mercredi 16 juin 2010 de 19h Ă 21h > marcher
La musique (tout) contre la danse ?
Journées d'études organisées les 18-19 mai 2009
Journées placées sous la direction de Laetitia Doat, Isabelle Launay, Philippe Guisgand, Armando Menicacci , Gianfranco Vinay.
Et organisées par l'université Paris 8 Saint-Denis, le Centre d'Études des Arts contemporains de l'université de Lille 3, et le Centre de Recherche sur l'Analyse et l'Interprétation en Musique et dans les Arts du spectacle (R.I.T.M.) de l'université de Nice.
Programme ci-joint.
Et organisées par l'université Paris 8 Saint-Denis, le Centre d'Études des Arts contemporains de l'université de Lille 3, et le Centre de Recherche sur l'Analyse et l'Interprétation en Musique et dans les Arts du spectacle (R.I.T.M.) de l'université de Nice.
Programme ci-joint.
Anachronismes
Cycle de trois conférences organisé en 2007-2008 par Théâtre de la Cité Internationale à Paris et le Département danse de l'université Paris 8 Saint-Denis
Coordonné par Christine Morquin et Julie Perrin.
Conférenciers, artistes : Isabelle Launay, Julie Perrin, Cécile Proust.
Le savoir historique est le fruit d'un regard présent sur le passé. Faire l'histoire de la danse comporte une part nécessaire d'anachronisme. Des chercheurs et des artistes proposent ici de rendre féconds des rapprochements incongrus, de mettre en regard différents chorégraphes pour mieux révéler un pan de leur esthétique, de poser des questions anciennes à l'art contemporain et réciproquement. Faire jouer l'anachronisme, c'est ainsi interroger l'acte de voir.
Ci-joint, le programme détaillé des conférences.
Conférenciers, artistes : Isabelle Launay, Julie Perrin, Cécile Proust.
Le savoir historique est le fruit d'un regard présent sur le passé. Faire l'histoire de la danse comporte une part nécessaire d'anachronisme. Des chercheurs et des artistes proposent ici de rendre féconds des rapprochements incongrus, de mettre en regard différents chorégraphes pour mieux révéler un pan de leur esthétique, de poser des questions anciennes à l'art contemporain et réciproquement. Faire jouer l'anachronisme, c'est ainsi interroger l'acte de voir.
Ci-joint, le programme détaillé des conférences.
Derrière l'œuvre, face Ă elle
Cycle de cinq conférences organisé en 2006-2007 par Théâtre de la Cité Internationale à Paris et le Département danse de l'université Paris 8 Saint-Denis
Coordonné par Christine Morquin et Julie Perrin.
Conférenciers, artistes : Mélanie Cholet, Max Fossati, Isabelle Ginot, Isabelle Launay, Julie Perrin, Dominique Praud, Alban Richard, Nathalie Schulmann
Au grand jour, apparaĂ®t la crĂ©ation chorĂ©graphique. Le temps d'une reprĂ©sentation, la danse est dĂ©voilĂ©e, offerte au regard du public, donnĂ©e en partage. Mais en amont, derrière l'œuvre, entre les reprĂ©sentations, les artistes connaissent une activitĂ© plus discrète, parfois intime. Pratique de soi, invention du geste, entraĂ®nement physique et questionnements Ă©changĂ©s, dĂ©ploiement d'un univers propre nourri de curiositĂ©s multiples : ces temps prĂ©cieux, nĂ©cessaires, irriguent la crĂ©ation. Ils supposent l'œuvre Ă venir.
Comment travaillent les danseurs et chorĂ©graphes prĂ©sents sur les scènes depuis les annĂ©es 80 ? Comment pensent-ils leur mĂ©tier et nourrissent-ils leur crĂ©ation ? Qu'est-ce qui les fait bouger, les fait crĂ©er ? Quel imaginaire les habite ? Cette face du travail de l'artiste chorĂ©graphique reste souvent bien mĂ©connue. Elle est difficile Ă saisir, mais la variĂ©tĂ© des esthĂ©tiques contemporaines rĂ©vèle, Ă elle seule, la diversitĂ© des dĂ©marches. Les danseurs invitĂ©s pourront en tĂ©moigner. La prĂ©sentation d'extraits vidĂ©os soutiendra le propos. Tenter de comprendre des cadres d'expĂ©riences ou d'envisager les ressorts d'une recherche artistique, c'est se donner les moyens d'atteindre l'intelligence singulière qui fonde une œuvre.
Ce cycle de cinq confĂ©rences proposait ainsi de se tourner vers le travail du danseur, de rĂ©flĂ©chir aux processus de crĂ©ation et de dĂ©celer, dans l'œuvre mĂŞme, les affleurements de ces pratiques de mouvement et de pensĂ©es qui sous-tendent la crĂ©ation. Autrement dit, effectuer ce voyage de l'univers du danseur et du chorĂ©graphe, vers l'expĂ©rience du spectateur.
Ci-joint, le programme détaillé des conférences.
Conférenciers, artistes : Mélanie Cholet, Max Fossati, Isabelle Ginot, Isabelle Launay, Julie Perrin, Dominique Praud, Alban Richard, Nathalie Schulmann
Au grand jour, apparaĂ®t la crĂ©ation chorĂ©graphique. Le temps d'une reprĂ©sentation, la danse est dĂ©voilĂ©e, offerte au regard du public, donnĂ©e en partage. Mais en amont, derrière l'œuvre, entre les reprĂ©sentations, les artistes connaissent une activitĂ© plus discrète, parfois intime. Pratique de soi, invention du geste, entraĂ®nement physique et questionnements Ă©changĂ©s, dĂ©ploiement d'un univers propre nourri de curiositĂ©s multiples : ces temps prĂ©cieux, nĂ©cessaires, irriguent la crĂ©ation. Ils supposent l'œuvre Ă venir.
Comment travaillent les danseurs et chorĂ©graphes prĂ©sents sur les scènes depuis les annĂ©es 80 ? Comment pensent-ils leur mĂ©tier et nourrissent-ils leur crĂ©ation ? Qu'est-ce qui les fait bouger, les fait crĂ©er ? Quel imaginaire les habite ? Cette face du travail de l'artiste chorĂ©graphique reste souvent bien mĂ©connue. Elle est difficile Ă saisir, mais la variĂ©tĂ© des esthĂ©tiques contemporaines rĂ©vèle, Ă elle seule, la diversitĂ© des dĂ©marches. Les danseurs invitĂ©s pourront en tĂ©moigner. La prĂ©sentation d'extraits vidĂ©os soutiendra le propos. Tenter de comprendre des cadres d'expĂ©riences ou d'envisager les ressorts d'une recherche artistique, c'est se donner les moyens d'atteindre l'intelligence singulière qui fonde une œuvre.
Ce cycle de cinq confĂ©rences proposait ainsi de se tourner vers le travail du danseur, de rĂ©flĂ©chir aux processus de crĂ©ation et de dĂ©celer, dans l'œuvre mĂŞme, les affleurements de ces pratiques de mouvement et de pensĂ©es qui sous-tendent la crĂ©ation. Autrement dit, effectuer ce voyage de l'univers du danseur et du chorĂ©graphe, vers l'expĂ©rience du spectateur.
Ci-joint, le programme détaillé des conférences.
L'histoire Ă l'œuvre
Cycle de sept conférences organisé en 2005-2006 par Théâtre de la Cité Internationale à Paris et le Département danse de l'université Paris 8 Saint-Denis
Conférenciers : Gaëlle Bourges, Isabelle Ginot, Isabelle Launay, Gérard Mayen, Julie Perrin, Claude Sorin.
Un cycle de sept confĂ©rences sur l'histoire de la danse moderne et contemporaine accompagnait la programmation de la saison 2005-2006. ConnaĂ®tre l'histoire de l'art chorĂ©graphique, en mesurer les enjeux, dĂ©couvrir les mouvements qui la traversent et les œuvres qui la hantent, c'est affiner la perception et la rĂ©flexion du spectateur sur la crĂ©ation prĂ©sente.
Ce cycle faisait alterner un parcours historique s'organisant autour de diffĂ©rentes pĂ©riodes, avec des thĂ©matiques traversant la crĂ©ation du vingtième siècle. Il s'organisait en rĂ©sonance avec les œuvres prĂ©sentĂ©es au Théâtre de la citĂ© Internationale.
Coordination : Julie Perrin. En collaboration avec les enseignants-chercheurs de la Formation danse de l'Université de Paris VIII Saint-Denis. Et Christine Morquin du Théâtre de la Cité Internationale à Paris.
Ci-joint, le programme détaillé des conférences.
Un cycle de sept confĂ©rences sur l'histoire de la danse moderne et contemporaine accompagnait la programmation de la saison 2005-2006. ConnaĂ®tre l'histoire de l'art chorĂ©graphique, en mesurer les enjeux, dĂ©couvrir les mouvements qui la traversent et les œuvres qui la hantent, c'est affiner la perception et la rĂ©flexion du spectateur sur la crĂ©ation prĂ©sente.
Ce cycle faisait alterner un parcours historique s'organisant autour de diffĂ©rentes pĂ©riodes, avec des thĂ©matiques traversant la crĂ©ation du vingtième siècle. Il s'organisait en rĂ©sonance avec les œuvres prĂ©sentĂ©es au Théâtre de la citĂ© Internationale.
Coordination : Julie Perrin. En collaboration avec les enseignants-chercheurs de la Formation danse de l'Université de Paris VIII Saint-Denis. Et Christine Morquin du Théâtre de la Cité Internationale à Paris.
Ci-joint, le programme détaillé des conférences.
