
|
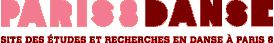
|

CHARGÃE DE COURS
DOCTORANTE
DÃPARTEMENT DANSE - UNIVERSITÃ PARIS 8
DOCTORANTE
DÃPARTEMENT DANSE - UNIVERSITÃ PARIS 8
PHILOSOPHIE DE L'ART, PHÃNOMÃNOLOGIE, ESTHÃTIQUE
HISTOIRE DE LA MODERNITÃ CHORÃGRAPHIQUE (EUROPE ET ÃTATS-UNIS)
ANALYSE DU MOUVEMENT, DES OEUVRES CHORÃGRAPHIQUES ET DES PROCESSUS DE TRANSMISSION
PRATIQUES ANTIQUES ET MODERNES DE L'EXTASE.
HISTOIRE DE LA MODERNITÃ CHORÃGRAPHIQUE (EUROPE ET ÃTATS-UNIS)
ANALYSE DU MOUVEMENT, DES OEUVRES CHORÃGRAPHIQUES ET DES PROCESSUS DE TRANSMISSION
PRATIQUES ANTIQUES ET MODERNES DE L'EXTASE.
AprÃĻs un cursus conjoint en philosophie à Paris 1 PanthÃĐon-Sorbonne et à l'Ãcole Normale SupÃĐrieure - Paris, Ulm (Master 2 et MagistÃĻre mention trÃĻs bien obtenus en 2008) oÃđ elle ÃĐtudie notamment de nombreux textes de l'histoire de la philosophie consacrÃĐs à la danse, Katharina Van Dyk complÃĻte sa formation universitaire à Paris 8 Vincennes - Saint-Denis avec un Master 2 en danse soutenu en 2010. Dans ce cadre, elle procÃĻde à une analyse historique et comparÃĐe (via l'analyse du mouvement) de plusieurs interprÃĐtations du solo Two Estatic Themes de Doris Humphrey (1931), en regard de la thÃĻse synchrone du phÃĐnomÃĐnologue et neuropsychiatre Erwin Straus concernant les implications sensibles et spatiales de l'expÃĐrience extatique en danse. De 2009 à 2012, elle est ÃĐgalement prÃĐsidente d'Anacrouse (association des ÃĐtudiants en danse de Paris 8) et rÃĐdactrice à la revue Funambule.
En octobre 2010, Katharina Van Dyk obtient un contrat doctoral au dÃĐpartement de philosophie de Paris 8 pour mener une recherche entre philosophie et ÃĐtudes en danse sous la direction de StÃĐphane Douailler (prof. philosophie) et d'Isabelle Launay (prof. danse). Ses enseignements sont mutualisÃĐs entre les deux dÃĐpartements et sont l'occasion de dÃĐvelopper une pÃĐdagogie transversale. Sa recherche porte sur l'expÃĐrience de l'extase en tant qu'elle nommerait le trait d'union entre philosophie et danse, la premiÃĻre thÃĐmatisant la seconde depuis ce concept et la seconde le prenant à son compte comme ce qui dÃĐcrit son propre fond tout en le convertissant en opÃĐrateur de crÃĐation pÃĐdagogique et chorÃĐgraphique. Dans cette perspective, Katharina Van Dyk se concentre plus particuliÃĻrement sur le contexte de la premiÃĻre modernitÃĐ chorÃĐgraphique depuis la fin du XIXe siÃĻcle jusqu'aux annÃĐes 1930, en Europe et aux Etats-Unis, particuliÃĻrement attachÃĐe à cette question depuis une interprÃĐtation de l'AntiquitÃĐ au prisme du dionysiaque, via l'aventure d'une lecture-artiste de figures comme Nietzsche, en profonde rÃĐsonnance et dialogue avec les savoirs et courants de pensÃĐe de l'ÃĐpoque : rÃĐÃĐvaluation romantique, vitalisme, symbolisme, phÃĐnomÃĐnologie, marxisme dissident, ethnologie et psychanalyse. Autant de regards qui tissent un rÃĐseau cohÃĐrent de rÃĐponses multiples à la question de la destinÃĐe anthropologique dans le contexte des mutations profondes de la modernitÃĐ industrielle et de la sociÃĐtÃĐ capitaliste. Cette prÃĐoccupation croise avec force celle de la premiÃĻre vague du fÃĐminisme qui se manifeste dans le champ chorÃĐgraphique par l'ÃĐmergence de figures de danseuses-auteures composant et ordonnant de part en part le rituel de leur extase en scÃĻne, sous le feu diurne des projecteurs, sans commandement tiers, maÃŪtre de ballet, chorÃĐgraphe ou directeur de thÃĐÃĒtre.
Tout en resituant les enjeux et principales articulations des transferts de concepts à percepts, le corpus se resserre principalement autour des œuvres d'Isadora Duncan, Mary Wigman et Doris Humphrey. A cet effet, Katharina Van Dyk mÃĻne un long travail en archive et de terrain pratique auprÃĻs de la transmission actuelle (aux Etats-Unis, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni), en dÃĐveloppant une mÃĐthodologie qui cherche le plus possible à expliciter les poÃŊÃĐtiques de l'extase depuis leur phÃĐnomÃĐnalitÃĐ concrÃĻte : stages, cours, ÂŦ entretiens dansÃĐs d'explicitation Âŧ, etc. Par là mÊme, elle cherche à produire, par cohÃĐrence avec son objet, une pensÃĐe et une ÃĐcriture qui parle de l'intÃĐrieur du savoir de danse, largement oral, initiatique et se produisant en studio (afin d'ÃĐviter l'ÃĐcueil d'une posture de ÂŦ surplomb Âŧ ou de ÂŦ survol Âŧ, dÃĐnoncÃĐe par Merleau-Ponty). Un constant aller-retour effectuÃĐ par un ÂŦ regard danseur Âŧ entre ces connaissances incorporÃĐes et les documents consultÃĐs permet de dÃĐfendre une recherche en danse au plus prÃĻs de ses singularitÃĐs ÃĐmergeantes.
Issue d'un cursus de danse modern-jazz en conservatoire à la fin des annÃĐes 1990 - dÃĐbut des annÃĐes 2000, Katharina Van Dyk fait de nombreux stages de danse moderne et contemporaine durant ses annÃĐes à Paris 8 et se forme à la technique et au rÃĐpertoire Isadora Duncan auprÃĻs d'Amy Swanson au studio du Regard du Cygne depuis 2013. Elle a ÃĐgalement suivi de nombreux cours et stages avec d'autres duncaniennes, à Londres, Munich et New York (parmi elles : Barbara Kane, Françoise Rageau, Adrienne Ramm, Astrid Schleusener, etc.). En 2015, avec Johana Giot et Audrey Margueritat, elle prÃĐsente un travail de reconstruction de la Danse des Furies (1911) d'Isadora Duncan au Festival des Dionysies à Paris. Elle intervient aussi auprÃĻs de diverses institutions (conservatoires, associations, thÃĐÃĒtres, maisons de quartier, etc.) pour proposer des initiations à la ÂŦ danse duncanienne Âŧ. Concernant la transmission wigmanienne, elle prend des cours et mÃĻne des entretiens avec Katharine Sehnert à Cologne et Jean Masse à Bordeaux. Les ateliers d'improvisation-composition auprÃĻs de Christine GÃĐrard (ÃĐlÃĻve de Jacqueline Robinson) nourrissent ÃĐgalement sa comprÃĐhension de cet hÃĐritage dans le cadre de la danse contemporaine française. A New York, elle assiste à un stage Humphrey-Limon avec Betty Jones et Fritz Ludin, prend des cours avec Gail Corbin et affine ses connaissances auprÃĻs de Francesca Todesco. Tout en prenant acte des transformations de ces pratiques au cours du temps, cette immersion permet d'en proposer une lecture poÃŊÃĐtique, et ainsi de sonder, ce qui en elles, fait extase. Par effet de retour, ce dÃĐplacement intempestif interroge les racines de la danse contemporaine dans leur familiaritÃĐ comme leur profonde ÃĐtrangetÃĐ eu ÃĐgard à elles.
Katharina Van Dyk ÃĐcrit de nombreux articles et contribue à divers ÃĐvÃĐnements scientifiques. En 2013, elle co-organise avec Pauline Nadrigny, Olga Moll et Christine Roquet le colloque international et transdisciplinaire ÂŦ Gestes et mouvements à l'œuvre. Une question danse-musique. XXe-XXIe siÃĻcle Âŧ (Paris 8, Paris 1, Labex Arts H2H) dont les actes sont publiÃĐs dans Filigrane (n°21, dÃĐcembre 2016).
Elle participe à la vie scientifique de ses laboratoires de rattachement en organisant notamment des journÃĐes d'ÃĐtude et de travail collectif au dÃĐpartement philosophie (ÂŦ Philosophie Art Politique Âŧ, avec Ninon GrangÃĐ, Bertrand Ogilvie et Mazarine Pingeot - 2014-2015) et dans le cadre des sÃĐminaires doctoraux et de recherche du dÃĐpartement danse (autour des thÃĻmes ÂŦ danse et philosophie Âŧ et des ÂŦ modernitÃĐs en danse Âŧ - 2013-2015). En 2015-2016, elle obtient un financement couplÃĐ de son universitÃĐ et du Centre National de la Danse (pÃīle patrimoine) pour inventorier la bibliothÃĻque et une partie des archives du philosophe Michel Bernard, fondateur du dÃĐpartement danse de Paris 8, projet qui aboutira à l'organisation d'une table-ronde au CND autour de l'apport du philosophe pour la pensÃĐe de la danse. En 2016-2017, elle co-organise avec Romain BigÃĐ une journÃĐe d'ÃĐtude ÂŦ Espaces dynamiques. ProblÃĐmatiques croisÃĐes entre danse et phÃĐnomÃĐnologie Âŧ sur le thÃĻme de ÂŦ L'accueil Âŧ à l'Ãcole Normale SupÃĐrieure (Paris). En novembre 2016, elle propose une intervention à deux voix avec Valentina Morales confrontant le travail chorÃĐgraphique de Doris Humphrey et celui de Pina Bausch lors du colloque international ÂŦ Cuerpo y ÃĐxtasis Âŧ organisÃĐ Ã l'UniversitÃĐ de Barcelone. Dans le cadre du colloque international ÂŦ Extase - Histoire et enjeux d'un concept d'expÃĐrience Âŧ (Paris, INHA, novembre 2018), organisÃĐ par Mildred Galland-Szymkowiak (CNRS-THALIM / projet ÂŦ Identification - Empathie - Projection dans les Arts sur spectacle Âŧ), Katharina Van Dyk expose une problÃĐmatisation et une synthÃĻse des expressions modernes des pratiques chorÃĐgraphiques dites ÂŦ extatiques Âŧ.
AprÃĻs trois annÃĐes d'enseignement au dÃĐpartement danse dans le cadre de son contrat doctoral, Katharina Van Dyk continue son activitÃĐ en tant que chargÃĐe de cours et ATER. En 2013-2014, elle donne ÃĐgalement des sÃĐminaires intensifs sur le ÂŦ corps percevant Âŧ dans le cadre de la formation nationale d'Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement DansÃĐ (CESMD de Poitou-Charentes). Elle codirige des mÃĐmoires de Master 1 et Master 2 en danse à Paris 8 et de fin d'ÃĐtude en AFCMD, orientÃĐs en esthÃĐtique. Son expertise est sollicitÃĐe pour la revue Recherches en danse de l'ACD et dans le cadre de la formation continue des enseignants de philosophie à l'AcadÃĐmie de Lille. En juin 2020, elle est prÃĐsidente du jury de fin d'ÃĐtudes de premier cycle supÃĐrieur en ÂŦ analyse et ÃĐcriture du mouvement - cinÃĐtographie Laban Âŧ, au Conservatoire National SupÃĐrieure de Musique et de Danse de Paris.
GrÃĒce au soutien financier et symbolique de ses laboratoires de rattachement, Katharina Van Dyk mÃĻne un important travail de recherche en archive en lien avec son sujet, qui la conduit à sÃĐjourner dans diffÃĐrents lieux dÃĐdiÃĐs à la danse : à la Public Library for the Performing Arts (Lincoln Center) à New York (2011 et 2014), au Tanzarchiv de Cologne (2014 et 2016), à l'Albert & Victoria Museum de Londres (2014) et dans diverses collections privÃĐes, non archivÃĐes, comme à l'Ãcole Elizabeth Duncan à Munich (2015) et chez des danseuses et/ou collectionneurs.
En complÃĐment de ces activitÃĐs, Katharina Van Dyk intervient dans diverses institutions de la scÃĻne chorÃĐgraphique contemporaine (CNDC d'Angers, etc.). Elle propose par exemple des confÃĐrences avec des artistes (comme avec Tatiana Julien au ThÃĐÃĒtre de la FaÃŊencerie - ScÃĻne Nationale de Creil en 2014, avec en amont un travail de sensibilisation auprÃĻs des ÃĐlÃĻves de l'option bac danse du lycÃĐe Malraux) et depuis peu des confÃĐrences-dansÃĐes à destination du grand public (ÂŦ Propos sur la modernitÃĐ chorÃĐgraphique Âŧ, MÃĐdiathÃĻque de Sainte-MÃĻre-Eglise & Vox, ScÃĻne Nationale de Cherbourg, 2018).
Les dÃĐplacements thÃĐorico-pratiques produits par l'ensemble de ce travail - sur fond d'une connaissance du champ actuel des ÃĐtudes en danse, de sa littÃĐrature comme de ses enjeux et mÃĐthodes - la conduisent aujourd'hui à achever sa thÃĻse en danse sous la direction d'Isabelle Launay (EDESTA, Paris 8), en codirection avec Renaud Barbaras (EDPH, Paris 1).
DerniÃĻre mise à jour: octobre 2021
En octobre 2010, Katharina Van Dyk obtient un contrat doctoral au dÃĐpartement de philosophie de Paris 8 pour mener une recherche entre philosophie et ÃĐtudes en danse sous la direction de StÃĐphane Douailler (prof. philosophie) et d'Isabelle Launay (prof. danse). Ses enseignements sont mutualisÃĐs entre les deux dÃĐpartements et sont l'occasion de dÃĐvelopper une pÃĐdagogie transversale. Sa recherche porte sur l'expÃĐrience de l'extase en tant qu'elle nommerait le trait d'union entre philosophie et danse, la premiÃĻre thÃĐmatisant la seconde depuis ce concept et la seconde le prenant à son compte comme ce qui dÃĐcrit son propre fond tout en le convertissant en opÃĐrateur de crÃĐation pÃĐdagogique et chorÃĐgraphique. Dans cette perspective, Katharina Van Dyk se concentre plus particuliÃĻrement sur le contexte de la premiÃĻre modernitÃĐ chorÃĐgraphique depuis la fin du XIXe siÃĻcle jusqu'aux annÃĐes 1930, en Europe et aux Etats-Unis, particuliÃĻrement attachÃĐe à cette question depuis une interprÃĐtation de l'AntiquitÃĐ au prisme du dionysiaque, via l'aventure d'une lecture-artiste de figures comme Nietzsche, en profonde rÃĐsonnance et dialogue avec les savoirs et courants de pensÃĐe de l'ÃĐpoque : rÃĐÃĐvaluation romantique, vitalisme, symbolisme, phÃĐnomÃĐnologie, marxisme dissident, ethnologie et psychanalyse. Autant de regards qui tissent un rÃĐseau cohÃĐrent de rÃĐponses multiples à la question de la destinÃĐe anthropologique dans le contexte des mutations profondes de la modernitÃĐ industrielle et de la sociÃĐtÃĐ capitaliste. Cette prÃĐoccupation croise avec force celle de la premiÃĻre vague du fÃĐminisme qui se manifeste dans le champ chorÃĐgraphique par l'ÃĐmergence de figures de danseuses-auteures composant et ordonnant de part en part le rituel de leur extase en scÃĻne, sous le feu diurne des projecteurs, sans commandement tiers, maÃŪtre de ballet, chorÃĐgraphe ou directeur de thÃĐÃĒtre.
Tout en resituant les enjeux et principales articulations des transferts de concepts à percepts, le corpus se resserre principalement autour des œuvres d'Isadora Duncan, Mary Wigman et Doris Humphrey. A cet effet, Katharina Van Dyk mÃĻne un long travail en archive et de terrain pratique auprÃĻs de la transmission actuelle (aux Etats-Unis, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni), en dÃĐveloppant une mÃĐthodologie qui cherche le plus possible à expliciter les poÃŊÃĐtiques de l'extase depuis leur phÃĐnomÃĐnalitÃĐ concrÃĻte : stages, cours, ÂŦ entretiens dansÃĐs d'explicitation Âŧ, etc. Par là mÊme, elle cherche à produire, par cohÃĐrence avec son objet, une pensÃĐe et une ÃĐcriture qui parle de l'intÃĐrieur du savoir de danse, largement oral, initiatique et se produisant en studio (afin d'ÃĐviter l'ÃĐcueil d'une posture de ÂŦ surplomb Âŧ ou de ÂŦ survol Âŧ, dÃĐnoncÃĐe par Merleau-Ponty). Un constant aller-retour effectuÃĐ par un ÂŦ regard danseur Âŧ entre ces connaissances incorporÃĐes et les documents consultÃĐs permet de dÃĐfendre une recherche en danse au plus prÃĻs de ses singularitÃĐs ÃĐmergeantes.
Issue d'un cursus de danse modern-jazz en conservatoire à la fin des annÃĐes 1990 - dÃĐbut des annÃĐes 2000, Katharina Van Dyk fait de nombreux stages de danse moderne et contemporaine durant ses annÃĐes à Paris 8 et se forme à la technique et au rÃĐpertoire Isadora Duncan auprÃĻs d'Amy Swanson au studio du Regard du Cygne depuis 2013. Elle a ÃĐgalement suivi de nombreux cours et stages avec d'autres duncaniennes, à Londres, Munich et New York (parmi elles : Barbara Kane, Françoise Rageau, Adrienne Ramm, Astrid Schleusener, etc.). En 2015, avec Johana Giot et Audrey Margueritat, elle prÃĐsente un travail de reconstruction de la Danse des Furies (1911) d'Isadora Duncan au Festival des Dionysies à Paris. Elle intervient aussi auprÃĻs de diverses institutions (conservatoires, associations, thÃĐÃĒtres, maisons de quartier, etc.) pour proposer des initiations à la ÂŦ danse duncanienne Âŧ. Concernant la transmission wigmanienne, elle prend des cours et mÃĻne des entretiens avec Katharine Sehnert à Cologne et Jean Masse à Bordeaux. Les ateliers d'improvisation-composition auprÃĻs de Christine GÃĐrard (ÃĐlÃĻve de Jacqueline Robinson) nourrissent ÃĐgalement sa comprÃĐhension de cet hÃĐritage dans le cadre de la danse contemporaine française. A New York, elle assiste à un stage Humphrey-Limon avec Betty Jones et Fritz Ludin, prend des cours avec Gail Corbin et affine ses connaissances auprÃĻs de Francesca Todesco. Tout en prenant acte des transformations de ces pratiques au cours du temps, cette immersion permet d'en proposer une lecture poÃŊÃĐtique, et ainsi de sonder, ce qui en elles, fait extase. Par effet de retour, ce dÃĐplacement intempestif interroge les racines de la danse contemporaine dans leur familiaritÃĐ comme leur profonde ÃĐtrangetÃĐ eu ÃĐgard à elles.
Katharina Van Dyk ÃĐcrit de nombreux articles et contribue à divers ÃĐvÃĐnements scientifiques. En 2013, elle co-organise avec Pauline Nadrigny, Olga Moll et Christine Roquet le colloque international et transdisciplinaire ÂŦ Gestes et mouvements à l'œuvre. Une question danse-musique. XXe-XXIe siÃĻcle Âŧ (Paris 8, Paris 1, Labex Arts H2H) dont les actes sont publiÃĐs dans Filigrane (n°21, dÃĐcembre 2016).
Elle participe à la vie scientifique de ses laboratoires de rattachement en organisant notamment des journÃĐes d'ÃĐtude et de travail collectif au dÃĐpartement philosophie (ÂŦ Philosophie Art Politique Âŧ, avec Ninon GrangÃĐ, Bertrand Ogilvie et Mazarine Pingeot - 2014-2015) et dans le cadre des sÃĐminaires doctoraux et de recherche du dÃĐpartement danse (autour des thÃĻmes ÂŦ danse et philosophie Âŧ et des ÂŦ modernitÃĐs en danse Âŧ - 2013-2015). En 2015-2016, elle obtient un financement couplÃĐ de son universitÃĐ et du Centre National de la Danse (pÃīle patrimoine) pour inventorier la bibliothÃĻque et une partie des archives du philosophe Michel Bernard, fondateur du dÃĐpartement danse de Paris 8, projet qui aboutira à l'organisation d'une table-ronde au CND autour de l'apport du philosophe pour la pensÃĐe de la danse. En 2016-2017, elle co-organise avec Romain BigÃĐ une journÃĐe d'ÃĐtude ÂŦ Espaces dynamiques. ProblÃĐmatiques croisÃĐes entre danse et phÃĐnomÃĐnologie Âŧ sur le thÃĻme de ÂŦ L'accueil Âŧ à l'Ãcole Normale SupÃĐrieure (Paris). En novembre 2016, elle propose une intervention à deux voix avec Valentina Morales confrontant le travail chorÃĐgraphique de Doris Humphrey et celui de Pina Bausch lors du colloque international ÂŦ Cuerpo y ÃĐxtasis Âŧ organisÃĐ Ã l'UniversitÃĐ de Barcelone. Dans le cadre du colloque international ÂŦ Extase - Histoire et enjeux d'un concept d'expÃĐrience Âŧ (Paris, INHA, novembre 2018), organisÃĐ par Mildred Galland-Szymkowiak (CNRS-THALIM / projet ÂŦ Identification - Empathie - Projection dans les Arts sur spectacle Âŧ), Katharina Van Dyk expose une problÃĐmatisation et une synthÃĻse des expressions modernes des pratiques chorÃĐgraphiques dites ÂŦ extatiques Âŧ.
AprÃĻs trois annÃĐes d'enseignement au dÃĐpartement danse dans le cadre de son contrat doctoral, Katharina Van Dyk continue son activitÃĐ en tant que chargÃĐe de cours et ATER. En 2013-2014, elle donne ÃĐgalement des sÃĐminaires intensifs sur le ÂŦ corps percevant Âŧ dans le cadre de la formation nationale d'Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement DansÃĐ (CESMD de Poitou-Charentes). Elle codirige des mÃĐmoires de Master 1 et Master 2 en danse à Paris 8 et de fin d'ÃĐtude en AFCMD, orientÃĐs en esthÃĐtique. Son expertise est sollicitÃĐe pour la revue Recherches en danse de l'ACD et dans le cadre de la formation continue des enseignants de philosophie à l'AcadÃĐmie de Lille. En juin 2020, elle est prÃĐsidente du jury de fin d'ÃĐtudes de premier cycle supÃĐrieur en ÂŦ analyse et ÃĐcriture du mouvement - cinÃĐtographie Laban Âŧ, au Conservatoire National SupÃĐrieure de Musique et de Danse de Paris.
GrÃĒce au soutien financier et symbolique de ses laboratoires de rattachement, Katharina Van Dyk mÃĻne un important travail de recherche en archive en lien avec son sujet, qui la conduit à sÃĐjourner dans diffÃĐrents lieux dÃĐdiÃĐs à la danse : à la Public Library for the Performing Arts (Lincoln Center) à New York (2011 et 2014), au Tanzarchiv de Cologne (2014 et 2016), à l'Albert & Victoria Museum de Londres (2014) et dans diverses collections privÃĐes, non archivÃĐes, comme à l'Ãcole Elizabeth Duncan à Munich (2015) et chez des danseuses et/ou collectionneurs.
En complÃĐment de ces activitÃĐs, Katharina Van Dyk intervient dans diverses institutions de la scÃĻne chorÃĐgraphique contemporaine (CNDC d'Angers, etc.). Elle propose par exemple des confÃĐrences avec des artistes (comme avec Tatiana Julien au ThÃĐÃĒtre de la FaÃŊencerie - ScÃĻne Nationale de Creil en 2014, avec en amont un travail de sensibilisation auprÃĻs des ÃĐlÃĻves de l'option bac danse du lycÃĐe Malraux) et depuis peu des confÃĐrences-dansÃĐes à destination du grand public (ÂŦ Propos sur la modernitÃĐ chorÃĐgraphique Âŧ, MÃĐdiathÃĻque de Sainte-MÃĻre-Eglise & Vox, ScÃĻne Nationale de Cherbourg, 2018).
Les dÃĐplacements thÃĐorico-pratiques produits par l'ensemble de ce travail - sur fond d'une connaissance du champ actuel des ÃĐtudes en danse, de sa littÃĐrature comme de ses enjeux et mÃĐthodes - la conduisent aujourd'hui à achever sa thÃĻse en danse sous la direction d'Isabelle Launay (EDESTA, Paris 8), en codirection avec Renaud Barbaras (EDPH, Paris 1).
DerniÃĻre mise à jour: octobre 2021
