
|
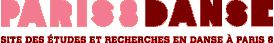
|
CONTRIBUTION DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS
Danzar con Pina. Aproximaciones para enunciar la experiencia de danza de los bailarines de Pina Bausch
in Poly Rodriguez et al. (ed.), El Libro de la Danza chilena, Chile, Primera edicion, 2019, p.678-685.
Danser chez Pina. Des approches pour ├®noncer l'exp├®rience de danse chez Pina Bausch
in Nicolas Burel (dir.), Corps et m├®thodologies, Paris, L'Harmattan, 2016, p. 131-142
ARTICLES
Vivre la rencontre chor├®graphique. Interrogations sur lŌĆÖimpact du virtuel au sein des pratiques en danse
Revue Multiples [En ligne], Centre Chor├®graphique National de Rillieux-la-Pape (CCNR), 2022-2023, p. 43-46.
Danser et se (con)fondre avec la terre
Itin├®raires [En ligne], 2021-1 | 2022, mis en ligne le 01 avril 2022
URL : http://journals.openedition.org/
R├®sum├® : En 1975, Pina Bausch (1940-2009) cr├®e sa propre version du Sacre du printemps, qui s'ajoute ├Ā la liste de plus de 204 versions de cette œuvre majeure sign├®e par Vaslav Nijinski en 1913. Dans sa pi├©ce, elle fait danser seize femmes et seize hommes litt├®ralement sur la terre. Mais cette terre-nature n'est pas seulement un ├®l├®ment de la sc├®nographie. Dans le cadre de cet article, je propose de revisiter cette œuvre embl├®matique de son r├®pertoire et de l'histoire de la danse depuis une perspective ├®cof├®ministe: comment l'├®criture chor├®graphique rend compte d'une relation particuli├©re de femmes vis-├Ā-vis de la terre ? Et comment cette relation nous permet-elle de comprendre une influence de la nature dans les gestes et dans une forme de corpor├®it├® fondamentale au sein de l'esth├®tique de la pi├©ce ? Nous verrons comment cette danse est porteuse d'un imaginaire f├®cond pour penser les questions ├®cof├®ministes d'un point de vue chor├®graphique. Ces questions d├®fendent un type de discours essentiel dans le mouvement, issu directement de l'exp├®rience de femmes.
R├®sum├® : En 1975, Pina Bausch (1940-2009) cr├®e sa propre version du Sacre du printemps, qui s'ajoute ├Ā la liste de plus de 204 versions de cette œuvre majeure sign├®e par Vaslav Nijinski en 1913. Dans sa pi├©ce, elle fait danser seize femmes et seize hommes litt├®ralement sur la terre. Mais cette terre-nature n'est pas seulement un ├®l├®ment de la sc├®nographie. Dans le cadre de cet article, je propose de revisiter cette œuvre embl├®matique de son r├®pertoire et de l'histoire de la danse depuis une perspective ├®cof├®ministe: comment l'├®criture chor├®graphique rend compte d'une relation particuli├©re de femmes vis-├Ā-vis de la terre ? Et comment cette relation nous permet-elle de comprendre une influence de la nature dans les gestes et dans une forme de corpor├®it├® fondamentale au sein de l'esth├®tique de la pi├©ce ? Nous verrons comment cette danse est porteuse d'un imaginaire f├®cond pour penser les questions ├®cof├®ministes d'un point de vue chor├®graphique. Ces questions d├®fendent un type de discours essentiel dans le mouvement, issu directement de l'exp├®rience de femmes.
Le solo de Pina Bausch dans Danz├│n (1995)... ou comment j'ai oubli├® les poissons
Recherches en danse [En ligne], n┬░ 10, 2021, mis en ligne le 14 d├®cembre 2021
URL : http://journals.openedition.org/danse/4395
R├®sum├® : Lors d'une s├®ance d'├®tude aux archives du Tanztheater Pina Bausch ├Ā Wuppertal, en janvier 2015, dans le cadre de ma recherche sur le solo de Pina Bausch dans Danz├│n (1995), dont les spectacles avaient lieu pendant ces m├¬mes jours, j'ai travaill├® avec une vid├®o de la pi├©ce o├╣ elle dansait ┬½ sans les poissons ┬╗ : les projections d'images immenses de poissons qui accompagnent sa danse ├®taient absentes, car exceptionnellement elles n'avaient pas fonctionn├® pendant la repr├®sentation. Cela m'a aid├® sp├®cialement ├Ā la visualisation des d├®tails des gestes. Cependant, grande a ├®t├® ma surprise lorsque plus tard, pendant un spectacle in vivo, les mouvements des poissons, leurs couleurs et leurs textures ont compl├©tement transform├® ma perception du geste et ainsi l'interpr├®tation de ce solo qui finalement est devenu une danse du lien et du rapport ├Ā l'autre. ├Ć travers cet article je partage une exp├®rience d'analyse dans laquelle, pour mieux comprendre le geste, il ne fallait pas l'isoler, mais le penser en relation aux autres ├®l├®ments du spectacle - musique, sc├®nographie, costumes, public - qui l'accompagnent et l'affectent.
R├®sum├® : Lors d'une s├®ance d'├®tude aux archives du Tanztheater Pina Bausch ├Ā Wuppertal, en janvier 2015, dans le cadre de ma recherche sur le solo de Pina Bausch dans Danz├│n (1995), dont les spectacles avaient lieu pendant ces m├¬mes jours, j'ai travaill├® avec une vid├®o de la pi├©ce o├╣ elle dansait ┬½ sans les poissons ┬╗ : les projections d'images immenses de poissons qui accompagnent sa danse ├®taient absentes, car exceptionnellement elles n'avaient pas fonctionn├® pendant la repr├®sentation. Cela m'a aid├® sp├®cialement ├Ā la visualisation des d├®tails des gestes. Cependant, grande a ├®t├® ma surprise lorsque plus tard, pendant un spectacle in vivo, les mouvements des poissons, leurs couleurs et leurs textures ont compl├©tement transform├® ma perception du geste et ainsi l'interpr├®tation de ce solo qui finalement est devenu une danse du lien et du rapport ├Ā l'autre. ├Ć travers cet article je partage une exp├®rience d'analyse dans laquelle, pour mieux comprendre le geste, il ne fallait pas l'isoler, mais le penser en relation aux autres ├®l├®ments du spectacle - musique, sc├®nographie, costumes, public - qui l'accompagnent et l'affectent.
TH├łSE ET HABILITATION
Une corpor├®it├® de la solitude. Pour une esth├®tique de la danse de Pina Bausch
Doctorat, d├®partement Danse Paris 8, sous la direction d'Isabelle Ginot, 2019
En tant que danseuse-chercheuse, ma question de d├®part est de comprendre le geste et la corpor├®it├®-dansante de Pina Bausch pour d├®finir les ├®l├®ments fondateurs de son style. Pour mieux me concentrer sur le geste, je travaille sur la figure du ┬½ solo ┬╗ chor├®graphique.
La premi├©re partie de la th├©se rend compte d'abord du parcours biographique et de sources gestuelles de Pina Bausch qui remontent ├Ā sa formation au sein de la Folkawangschule ├Ā Essen,entre 1955 et 1960, et ├Ā New York, entre 1960 et 1962, au sein de la Juilliard School. Dans un deuxi├©me chapitre, je propose une p├®riodisation de l'oeuvre de la chor├®graphe depuis qu'elle prend la direction du Tanztheater Wuppertal en 1973.
Dans la deuxi├©me partie, j'analyse les seuls deux soli dans├®s par Pina Bausch avec sa compagnie - Caf├® M├╝ller (1978) et Danz├│n (1995) - et dans la troisi├©me partie, trois solidans├®s par ses interpr├©tes, dans : Le Sacre du printemps (1975), Nelken (1982), et ...como el musguito en la piedra ay si, si, si...' (2009).
De l├Ā a ├®merg├®, parmi les ├®l├®ments de cette corpor├®it├®-dansante, la question de la solitude qui probl├®matise les notions de solo, solitude et ├¬tre-ensemble en danse. A savoir, comment ┬½ danser-tout-seul ┬╗ et ┬½ danser-ensemble ┬╗ deviennent des possibilit├®s d'habiter l'espace sc├®nique au-del├Ā du nombre d'interpr├©tes sur sc├©ne ? ├Ć quelle condition, la notion de solitude chez Pina Bausch constitue, non pas une ┬½ th├®matique ┬╗ visant ├Ā expliquer ses pi├©ces mais une forme de corpor├®it├® fondatrice de sa danse ? Quelles sont les particularit├®s de ce style qui r├®side autant dans la corpor├®it├® de Pina Bausch - en tant que danseuse - que dans celle de chacun de ses interpr├©tes ?
A corporeality of loneliness
For an aesthetic of Pina Bausch's dance
As a dancer researcher, my point of departure is to comprehend Pina Bausch's move and dancing corporeality in order to define the founding elements of her style. To improve my focus on the move I work on the figure of the choreographic solo.
The first part of the thesis realizes firstly the biographical path and the source of Pina Bausch moves dating back to her training within Folkawangschule in Essen, from 1955 to 1960,and in New York, from 1960 to 1962, within Julliard School. In a second chapter, I propose a periodization of her work starting after she took charge of Tanztheater Wuppertal in 1973.
In the second part, I analyze the only two soli dances by Pina Bausch with her company - Caf├® Muller (1978) and Danz├│n (1995) - and in the third part, three soli dances by her interpreters , in : The Rite of Spring (1975), Nelken (1982), and ...como el musguito en la piedra ay si, si, si...' (2009).
From this, among all the elements of this dancing corporeality, emerges the question of solitude that problematizes the notions of solo, solitude, loneliness and being together in dance.
Namely, how do dancing-all-alone and dancing-together become the possibilities to inhabit the scenic space beyond the number of interpreters on stage ? Under what condition, do Pina Bausch's notion of solitude constitute not only a topic to explain her pieces but a sort of founding corporeality to her dance ? What are the particularities of her style that reside equally in Pina Bausch's corporeality - as a dancer - and in each of her interpreters ?
La premi├©re partie de la th├©se rend compte d'abord du parcours biographique et de sources gestuelles de Pina Bausch qui remontent ├Ā sa formation au sein de la Folkawangschule ├Ā Essen,entre 1955 et 1960, et ├Ā New York, entre 1960 et 1962, au sein de la Juilliard School. Dans un deuxi├©me chapitre, je propose une p├®riodisation de l'oeuvre de la chor├®graphe depuis qu'elle prend la direction du Tanztheater Wuppertal en 1973.
Dans la deuxi├©me partie, j'analyse les seuls deux soli dans├®s par Pina Bausch avec sa compagnie - Caf├® M├╝ller (1978) et Danz├│n (1995) - et dans la troisi├©me partie, trois solidans├®s par ses interpr├©tes, dans : Le Sacre du printemps (1975), Nelken (1982), et ...como el musguito en la piedra ay si, si, si...' (2009).
De l├Ā a ├®merg├®, parmi les ├®l├®ments de cette corpor├®it├®-dansante, la question de la solitude qui probl├®matise les notions de solo, solitude et ├¬tre-ensemble en danse. A savoir, comment ┬½ danser-tout-seul ┬╗ et ┬½ danser-ensemble ┬╗ deviennent des possibilit├®s d'habiter l'espace sc├®nique au-del├Ā du nombre d'interpr├©tes sur sc├©ne ? ├Ć quelle condition, la notion de solitude chez Pina Bausch constitue, non pas une ┬½ th├®matique ┬╗ visant ├Ā expliquer ses pi├©ces mais une forme de corpor├®it├® fondatrice de sa danse ? Quelles sont les particularit├®s de ce style qui r├®side autant dans la corpor├®it├® de Pina Bausch - en tant que danseuse - que dans celle de chacun de ses interpr├©tes ?
A corporeality of loneliness
For an aesthetic of Pina Bausch's dance
As a dancer researcher, my point of departure is to comprehend Pina Bausch's move and dancing corporeality in order to define the founding elements of her style. To improve my focus on the move I work on the figure of the choreographic solo.
The first part of the thesis realizes firstly the biographical path and the source of Pina Bausch moves dating back to her training within Folkawangschule in Essen, from 1955 to 1960,and in New York, from 1960 to 1962, within Julliard School. In a second chapter, I propose a periodization of her work starting after she took charge of Tanztheater Wuppertal in 1973.
In the second part, I analyze the only two soli dances by Pina Bausch with her company - Caf├® Muller (1978) and Danz├│n (1995) - and in the third part, three soli dances by her interpreters , in : The Rite of Spring (1975), Nelken (1982), and ...como el musguito en la piedra ay si, si, si...' (2009).
From this, among all the elements of this dancing corporeality, emerges the question of solitude that problematizes the notions of solo, solitude, loneliness and being together in dance.
Namely, how do dancing-all-alone and dancing-together become the possibilities to inhabit the scenic space beyond the number of interpreters on stage ? Under what condition, do Pina Bausch's notion of solitude constitute not only a topic to explain her pieces but a sort of founding corporeality to her dance ? What are the particularities of her style that reside equally in Pina Bausch's corporeality - as a dancer - and in each of her interpreters ?
