
|
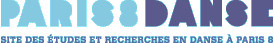
|
OUVRAGES
Arc, a choreographed poem
St. Catharines, ON / Vienna, Austria: Small Walker Press / Salon f├╝r Kunstbuch, 2021
Co-auteur : Paul Savoie
Litt├®radanse. Quand la chor├®graphie s'empare du texte litt├®raire.
L'Harmattan, coll. "univers de la danse", 2018 (232 pages)
Fanny de Chaill├®, Daniel Dobbels, Antoine Dufeu et Jonah Bokaer
La pr├®sente ├®tude propose de se glisser dans les d├®tails de quatre chor├®graphies pour s'int├®resser aux frottements des mots et de la danse.
Lorsque sur sc├©ne je per├¦ois un texte lu en m├¬me temps que des corps en mouvement, une œuvre ├®merge, qui ne se r├®duit ni ├Ā la partition parl├®e ni ├Ā la partition dans├®e, mais qui se situe dans l'acte m├¬me de leur mise en pr├®sence. Cette œuvre, je l'appelle ┬½ litt├®radanse ┬╗ : un mot-valise qui rend sensible la juxtaposition sans en effacer les sutures.
Les lectures crois├®es du "Groupe" de Fanny de Chaill├®, de la "Fille qui danse" et d' "Un son ├®trange" de Daniel Dobbels et de "Museum of nothing" de Jonah Bokaer et Antoine Dufeu me permettent de proposer plusieurs fa├¦ons d'appr├®hender les inflexions r├®ciproques de la litt├®rature et de la danse, tout en conservant l'aspect t├®nu et mouvant du sens qui se construit dans le temps d'un spectacle
La pr├®sente ├®tude propose de se glisser dans les d├®tails de quatre chor├®graphies pour s'int├®resser aux frottements des mots et de la danse.
Lorsque sur sc├©ne je per├¦ois un texte lu en m├¬me temps que des corps en mouvement, une œuvre ├®merge, qui ne se r├®duit ni ├Ā la partition parl├®e ni ├Ā la partition dans├®e, mais qui se situe dans l'acte m├¬me de leur mise en pr├®sence. Cette œuvre, je l'appelle ┬½ litt├®radanse ┬╗ : un mot-valise qui rend sensible la juxtaposition sans en effacer les sutures.
Les lectures crois├®es du "Groupe" de Fanny de Chaill├®, de la "Fille qui danse" et d' "Un son ├®trange" de Daniel Dobbels et de "Museum of nothing" de Jonah Bokaer et Antoine Dufeu me permettent de proposer plusieurs fa├¦ons d'appr├®hender les inflexions r├®ciproques de la litt├®rature et de la danse, tout en conservant l'aspect t├®nu et mouvant du sens qui se construit dans le temps d'un spectacle
CONTRIBUTION DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS
Mal├®dictions chr├®tiennes
in Michel Cartry, Jean-Louis Durand, Ren├®e Koch Piettre (dir.), Architecturer l'invisible. Autels, ligatures, ├®critures, Turnhout, Brepols, 2009, p. 292-305
ARTICLES
Qu'on puisse me traverser
in En danseuse, projet d'Alain Michard, [en ligne], 2019
Qu'est-ce que l'art chor├®graphique peut montrer du corps migrant ?
in Voix Plurielles, Vol. 15 No 2 (2018), Rubrique "R├®flexions sur l'art du mouvement" (Dir. Sarah Anthony), pp. 33-48
Qu'est-ce que l'art chor├®graphique peut montrer du corps migrant ? Une ├®tude des chor├®graphies Ethnoscape de C├®cile Proust et Rester. ├ētranger de Barbara Manzetti
R├®sum├®
Lorsqu'une chor├®graphie comme Ethnoscape de C├®cile Proust, qui traite du sujet des migrations humaines, est pr├®sent├®e sur sc├©ne au public, elle se trouve prise dans un contexte de r├®ception politique et ├®thique d'autant plus br├╗lant qu'il touche ├Ā une actualit├® imm├®diate et m├®diatis├®e. C'est cette rencontre que l'article propos├® commence par interroger : comment rendre pr├®sents les corps des immigr├®s, ├Ā travers leurs t├®moignages, leurs voix, leurs images ? Leur pr├®sence diff├®r├®e ne marque-t-elle pas in├®luctablement leur absence ? Comparant ce projet avec celui de Barbara Manzetti qui fait venir des r├®fugi├®s politiques dans le lieu de sa r├®sidence artistique, je m'emploie ├Ā montrer que ces choix ne hi├®rarchisent en aucun cas la valeur des œuvres, mais sont fondamentaux quant ├Ā la fa├¦on dont chacune des chor├®graphies tend ├Ā s'inscrire dans le discours contextuel sur la migration. Changeant d'├®chelle, je peux alors montrer que la d├®marche chor├®graphique de Proust ne se limite pas ├Ā s'inscrire dans la pol├®mique d'une ├®poque, mais qu'elle est l'histoire de toute une vie o├╣ danse et migration sont intimement li├®es, et o├╣ il s'agit de chor├®graphier le mouvement du voyage et de la rencontre.
en ligne
https://journals.library.brocku.ca/index.php/voixplurielles/article/view/2072
R├®sum├®
Lorsqu'une chor├®graphie comme Ethnoscape de C├®cile Proust, qui traite du sujet des migrations humaines, est pr├®sent├®e sur sc├©ne au public, elle se trouve prise dans un contexte de r├®ception politique et ├®thique d'autant plus br├╗lant qu'il touche ├Ā une actualit├® imm├®diate et m├®diatis├®e. C'est cette rencontre que l'article propos├® commence par interroger : comment rendre pr├®sents les corps des immigr├®s, ├Ā travers leurs t├®moignages, leurs voix, leurs images ? Leur pr├®sence diff├®r├®e ne marque-t-elle pas in├®luctablement leur absence ? Comparant ce projet avec celui de Barbara Manzetti qui fait venir des r├®fugi├®s politiques dans le lieu de sa r├®sidence artistique, je m'emploie ├Ā montrer que ces choix ne hi├®rarchisent en aucun cas la valeur des œuvres, mais sont fondamentaux quant ├Ā la fa├¦on dont chacune des chor├®graphies tend ├Ā s'inscrire dans le discours contextuel sur la migration. Changeant d'├®chelle, je peux alors montrer que la d├®marche chor├®graphique de Proust ne se limite pas ├Ā s'inscrire dans la pol├®mique d'une ├®poque, mais qu'elle est l'histoire de toute une vie o├╣ danse et migration sont intimement li├®es, et o├╣ il s'agit de chor├®graphier le mouvement du voyage et de la rencontre.
en ligne
https://journals.library.brocku.ca/index.php/voixplurielles/article/view/2072
A.I.M.E., un laboratoire chor├®graphique du sensible
in Culture et Recherche n┬░136, automne-hiver 2017, pp. 40-41
Article ├Ā trois mains, issu d'un entretien de Julie Nioche et Isabelle Ginot, men├® et r├®dig├® par M├®lanie Mesager.
Consultable en ligne :
http://fr.calameo.com/read/0053751144f0581485d52
Consultable en ligne :
http://fr.calameo.com/read/0053751144f0581485d52
Redire la danse : les savoirs du corps
Les cahiers Linguatek, No.1-2/2017 : "Corps et langage", pp. 9-20
Qu'est-ce que la danse fait au corps┬Ā? C'est la question que Sabine Macher, se faisant ethnographe de sa propre tribu, pose aux danseurs de la M├®nagerie de verre ├Ā l'issue de leur cours. M'emparant des entretiens ainsi produits, j'en propose une analyse qui, partant du postulat que le corps ayant dans├® se construit dans le pr├®sent du discours, montre que cette construction v├®hicule des savoirs du corps, ├Ā la fois au sens subjectif et objectif┬Ā: des savoirs sur le corps et des savoirs par le corps. A la repr├®sentation anatomique du corps que S. Macher sugg├©re dans ses questions, les danseurs r├®pondent par celle d'un corps global, dont la forme peut varier selon la sensation qu'on en a, qui se dilate, s'ouvre au milieu qui l'entoure, et, tour ├Ā tour, se confond et s'├®loigne du sujet parlant. Ces repr├®sentations t├®moignent de points de vue qui se manifestent dans la tension de l'├®nonciation, et contribuent ├Ā faire du corps un objet d'attention autant qu'un v├®hicule de l'attention vers le monde.
Mais ni le corps ni le monde ne sont v├®ritablement constitu├®s en objets dans les discours┬Ā: le v├®ritable objet dont parlent les danseurs, c'est la fa├¦on dont le corps est ├Ā la fois senti et sentant, la fa├¦on dont il se connecte pour s'ouvrir au monde. Cette fa├¦on d'├®noncer la danse comme un acte perceptif de souci de soi prend place dans un ordre des discours de la danse contemporaine, valorisant, ├Ā travers les notions de ┬½┬Āconnexion┬Ā┬╗, d' ┬½┬Āouverture┬Ā┬╗, de ┬½┬Ādisponibilit├®┬Ā┬╗ une ┬½┬Ācertaine danse┬Ā┬╗ qui lib├©re le corps et le mouvement, et o├╣ le bien et le juste ne sont pas des valeurs esth├®tiques mais sensorielles.
article complet disponible en ligne :
http://limbistraine.tuiasi.ro/images/8.%20Centrul%20de%20limbi%20moderne/RevueLesCahiersLinguatek.pdf
Mais ni le corps ni le monde ne sont v├®ritablement constitu├®s en objets dans les discours┬Ā: le v├®ritable objet dont parlent les danseurs, c'est la fa├¦on dont le corps est ├Ā la fois senti et sentant, la fa├¦on dont il se connecte pour s'ouvrir au monde. Cette fa├¦on d'├®noncer la danse comme un acte perceptif de souci de soi prend place dans un ordre des discours de la danse contemporaine, valorisant, ├Ā travers les notions de ┬½┬Āconnexion┬Ā┬╗, d' ┬½┬Āouverture┬Ā┬╗, de ┬½┬Ādisponibilit├®┬Ā┬╗ une ┬½┬Ācertaine danse┬Ā┬╗ qui lib├©re le corps et le mouvement, et o├╣ le bien et le juste ne sont pas des valeurs esth├®tiques mais sensorielles.
article complet disponible en ligne :
http://limbistraine.tuiasi.ro/images/8.%20Centrul%20de%20limbi%20moderne/RevueLesCahiersLinguatek.pdf
TH├łSE ET HABILITATION
L'entretien comme pratique chor├®graphique. ├ētude des interactions verbales dans quatre œuvres quasi-ethnographiques
Doctorat, universit├® Paris 8, sous la direction d'Isabelle Ginot, 2021
Direladanse de Sabine Macher, Ethnoscape de C├®cile Proust, Autour de la table de Lo├»c Touz├® et Anne Kerzerho, Les Situations construites de Tino Sehgal.
Cette ├®tude a pour objet quatre œuvres artistiques compos├®es par des chor├®graphes qui rev├¬tent la forme d'enqu├¬tes quasi-ethnographiques et engagent des interactions verbales entre diff├®rents participants, sur le mode de l'entretien. Mon propos est avant tout de montrer que ces enqu├¬tes sont des chor├®graphies et les entretiens une de leur mati├©re. ├Ć ce titre, la partition des interactions verbales, comme ├®criture de dynamiques sous-jacentes aux situations d'interlocution, participe de l'esth├®tique singuli├©re de chaque œuvre. Selon un mod├©le emprunt├® ├Ā la s├®miotique des interactions, mon ├®tude s'emploie ├Ā repr├®senter les partitions qui r├®gissent les prises de parole dans chaque œuvre, et d├®finissent ainsi le r├┤le des participants et la nature du risque qu'ils prennent ├Ā se parler. Les discours qui se construisent de cette fa├¦on dans chaque situation produisent du sens r├®f├®rentiel : les entretiens parlent du corps dansant, de la migration comme voyage, du geste au travail, d'anecdotes personnelles. Ce sens, qui tend vers un en dehors de l'œuvre, participe ├®galement de son esth├®tique, mais ne se comprend que dans le contexte de l'├®nonciation : il d├®pend ├Ā la fois des partitions d'interaction et du contexte chor├®graphique dans lequel s'accomplissent les actes de langage. Ainsi d├®fini, le sens r├®f├®rentiel construit diff├®rentes relations des œuvres ├Ā la r├®alit├®, qui peuvent aller de la repr├®sentation factuelle ├Ā une construction efficace de la r├®alit├® r├®f├®rentielle dans le temps de l'├®nonciation. Dans ce sens, mon ├®tude s'attache, en derni├©re analyse, aux diff├®rentes fa├¦ons qu'ont ces chor├®graphies quasi-ethnographiques et les entretiens qui les composent d'habiter le monde et, ce faisant, de le transformer.
Cette ├®tude a pour objet quatre œuvres artistiques compos├®es par des chor├®graphes qui rev├¬tent la forme d'enqu├¬tes quasi-ethnographiques et engagent des interactions verbales entre diff├®rents participants, sur le mode de l'entretien. Mon propos est avant tout de montrer que ces enqu├¬tes sont des chor├®graphies et les entretiens une de leur mati├©re. ├Ć ce titre, la partition des interactions verbales, comme ├®criture de dynamiques sous-jacentes aux situations d'interlocution, participe de l'esth├®tique singuli├©re de chaque œuvre. Selon un mod├©le emprunt├® ├Ā la s├®miotique des interactions, mon ├®tude s'emploie ├Ā repr├®senter les partitions qui r├®gissent les prises de parole dans chaque œuvre, et d├®finissent ainsi le r├┤le des participants et la nature du risque qu'ils prennent ├Ā se parler. Les discours qui se construisent de cette fa├¦on dans chaque situation produisent du sens r├®f├®rentiel : les entretiens parlent du corps dansant, de la migration comme voyage, du geste au travail, d'anecdotes personnelles. Ce sens, qui tend vers un en dehors de l'œuvre, participe ├®galement de son esth├®tique, mais ne se comprend que dans le contexte de l'├®nonciation : il d├®pend ├Ā la fois des partitions d'interaction et du contexte chor├®graphique dans lequel s'accomplissent les actes de langage. Ainsi d├®fini, le sens r├®f├®rentiel construit diff├®rentes relations des œuvres ├Ā la r├®alit├®, qui peuvent aller de la repr├®sentation factuelle ├Ā une construction efficace de la r├®alit├® r├®f├®rentielle dans le temps de l'├®nonciation. Dans ce sens, mon ├®tude s'attache, en derni├©re analyse, aux diff├®rentes fa├¦ons qu'ont ces chor├®graphies quasi-ethnographiques et les entretiens qui les composent d'habiter le monde et, ce faisant, de le transformer.
